Listen to the article
A ma gauche « un film antifasciste pour une époque fasciste ». A ma droite « une apologie du terrorisme ». La polarisation des Etats-Unis ne manque pas de carburant. Pourtant voilà que ses hérauts, dans chacun des deux camps, vont en chercher au cinéma. Deux semaines après sa sortie, Une bataille après l’autre, le dixième long métrage de Paul Thomas Anderson, est devenu un enjeu politique majeur, jetant dans le débat des journalistes, des polémistes qui d’ordinaire se préoccupent plus de politique migratoire ou de droits reproductifs.
La pertinence historique d’un film est forcément au moins en partie accidentelle. Des années s’écoulent entre la naissance d’un projet et son apparition dans les salles. Depuis longtemps, Anderson avait fait part de son désir d’adapter Vineland, le roman de Thomas Pynchon paru en 1990, situé en 1984, évocation cryptique de la désillusion qui saisit les militants des années 1980 sous la présidence de Ronald Reagan. Le temps d’écrire un scénario qui n’a plus qu’un lointain rapport avec Vineland, de convaincre Warner Bros. Discovery de financer le film à hauteur de 130 millions de dollars (112 millions d’euros) et Leonardo DiCaprio d’en être la vedette, on était déjà au printemps 2024. Une bataille après l’autre a été tourné pendant la dernière campagne présidentielle américaine, à un moment où son issue restait incertaine.
Les partisans du film y voient le signe de la puissance prophétique de Paul Thomas Anderson, ses contempteurs de l’immuable partialité de Hollywood. Il faut bien convenir que la partie centrale du film, qui montre le méchant colonel Steven J. Lockjaw, incarné par Sean Penn, partir avec ses troupes à l’assaut d’une ville où les migrants sont assurés de trouver refuge, semant le chaos et multipliant les provocations, ressemble furieusement aux reportages venus de Los Angeles ou de Chicago ces derniers mois.
Choix fondamentaux
Cette ressemblance (et quelques autres) a suffi pour occuper des térabytes d’éditoriaux, de posts de blogs ou de vidéos. La qualification de « film antifasciste » se trouve dans un éditorial de Michelle Goldberg du New York Times. Sa consœur critique de cinéma Manohla Dargis parle, elle, de « cri de ralliement ». Les commentaires sur les résultats d’Une bataille après l’autre au box-office portent autant sur son efficacité politique (au-dessus de 100 millions de dollars de recettes, on peut espérer que le film aura touché au-delà des convertis) que sur sa rentabilité.
Il vous reste 57.3% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



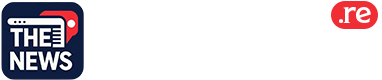
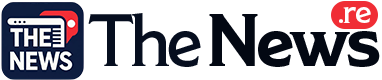





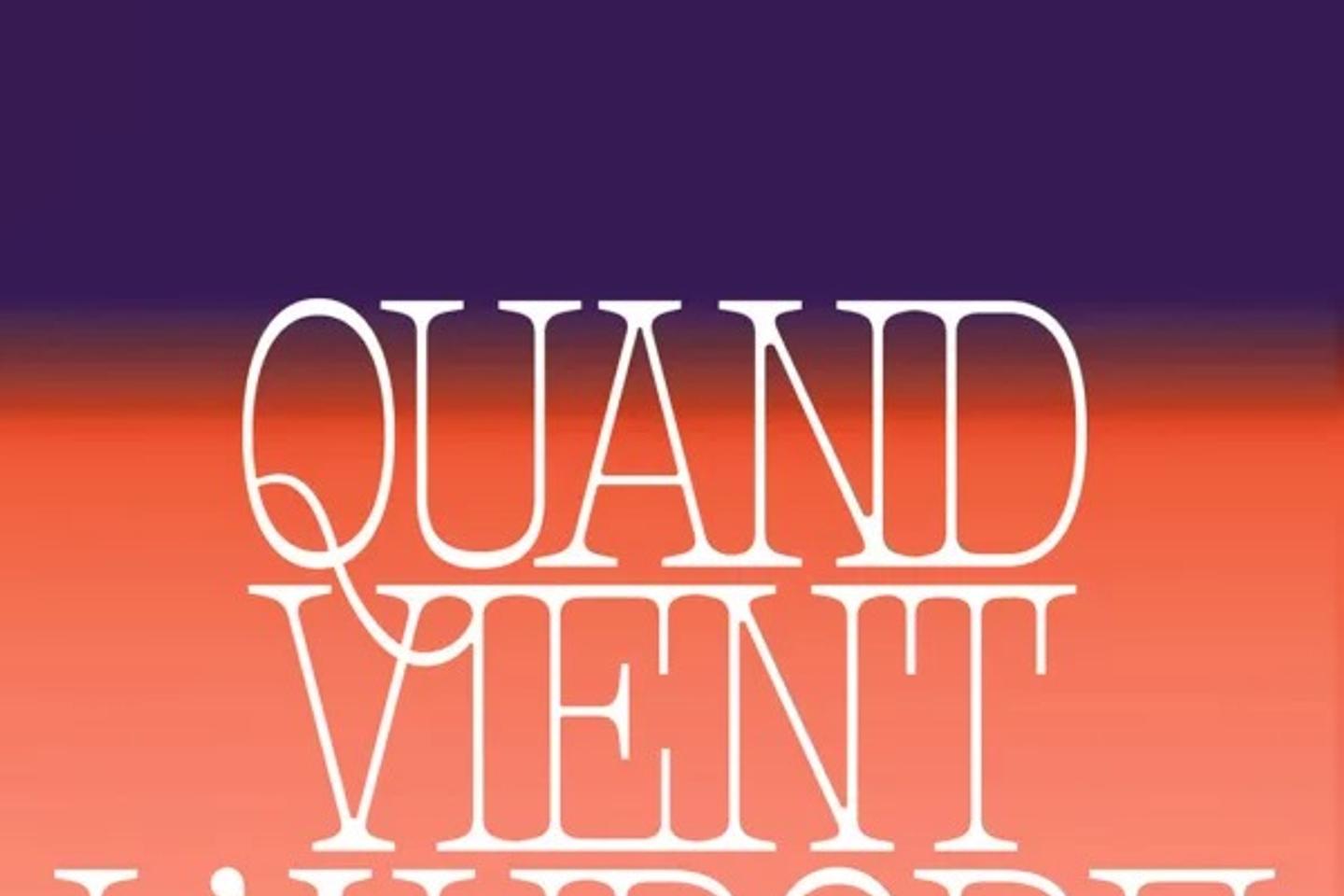
10 commentaires
Intéressant de voir comment un film peut devenir un symbole politique malgré son scénario détourné.
Les budgets du cinéma sont hallucinants, mais 130 millions de dollars pour un long métrage ? Ça dépasse l’entendement.
Pour un film avec Leonardo DiCaprio, peut-être, mais c’est tout de même exagéré.
La guerre culturelle aux États-Unis ne connaît pas de limites, pas même celles du cinéma.
Effectivement, chaque détail devient un prétexte pour les deux camps.
Pourquoi un film sur les années 1980 fait-il autant débat aujourd’hui ? La nostalgie a ses limites.
Probablement parce qu’il touche à des problématiques toujours d’actualité, malgées les années écoulées.
112 millions d’euros pour un seul film ? J’espère que les recettes seront à la hauteur de l’investissement.
Le cinéma est souvent un révélateur de tensions sociales, mais cette fois, c’est lui qui devient le terrain de ces tensions.
Adopter Vineland de Pynchon était audacieux, même si le résultat final semble éloigné de l’œuvre originale.