Listen to the article
Pendant longtemps, le concubinage n’a pas eu de statut dans le code civil. On prête d’ailleurs à Bonaparte, premier consul, qui fut à l’initiative du code et promulgua celui-ci, la phrase suivante : « Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux. »
C’est seulement en 1999 que le législateur l’a qualifié d’« union de fait », par opposition aux unions imposant un cadre juridique que constituaient le mariage et le tout nouveau pacte civil de solidarité (pacs).
Puisque les concubins n’ont pas les devoirs des personnes mariées ou pacsées, ils n’en ont pas, non plus, les droits. Ils ne peuvent pas, notamment, se prévaloir d’une disposition sur la prescription destinée à préserver la paix des ménages. C’est ce que rappelle l’affaire suivante.
En août 2019, M. X et Mme Y, concubins depuis plus de vingt ans, se séparent, après avoir élevé deux enfants. Ils ne s’entendent pas sur le sort du logement familial, acheté en indivision par moitié, mais financé presque exclusivement par M. X. Ce dernier a non seulement fait deux apports de 30 000 euros, en retirant de l’argent de sa caisse de retraite suisse – qu’il doit rembourser –, mais aussi payé la plupart des échéances des emprunts.
« Impossibilité morale »
Lorsque, le 6 mai 2021, un juge ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, il revendique une créance sur l’indivision. Mme Y lui oppose la prescription de son action, de cinq ans à compter du jour où il se savait créancier, c’est-à-dire où il a payé (article 2224 du code civil).
M. X réplique que la prescription « ne court pas ou est suspendue » pendant la durée de la vie commune : ce principe, prévu par l’article 2236 du code civil, est destiné à éviter que les conjoints ou les partenaires agissent l’un contre l’autre, par simple crainte de la prescription. C’est seulement quand le divorce a acquis force de chose jugée ou que la dissolution du pacs a été enregistrée que la prescription commence à courir. Mais l’article 2236 ne s’applique pas aux concubins.
Il vous reste 40.32% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



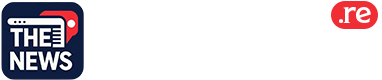
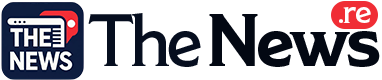






15 commentaires
La présidence de Bonaparte a marqué le code civil, mais certaines de ses décisions semblent aujourd’hui dépassées.
Cette histoire soulève des questions sur l’équité entre les couples mariés et concubins. Le droit devrait-il évoluer pour mieux protéger les concubins dans de telles situations ?
Le mariage offre une sécurité juridique, mais beaucoup préfèrent le concubinage. Faut-il vraiment alourdir les règles ?
C’est un débat complexe, surtout avec les disparités financières comme dans ce cas. Une réforme pourrait être nécessaire.
Intéressant de voir comment le droit évolue avec les changements sociétaux. La reconnaissance des droits des concubins reste limitée, semble-t-il.
Oui, et c’est souvent après des affaires comme celle-ci que la loi bouge. Mais cela prend du temps.
Une indemnisation pour l’ex-concubin ne serait-elle pas possible, même sans mariage ? Certains juges pourraient l’envisager.
Un apport financier substantiel comme ici pourrait justifier une compensation, même sans cadre légal. La morale jouera-t-elle un rôle ?
Ce genre d’affaire montre bien pourquoi beaucoup optent pour un PACS ou le mariage. La sécurité juridique a son importance.
Le code civil a longtemps ignoré les concubins, et cela complique les choses aujourd’hui. Un statut clair serait bienvenu.
Cependant, vouloir tout réguler pourrait aussi engendrer des problèmes. L’équilibre est difficile à trouver.
Le législateur a tenté de clarifier la situation en 1999, mais des lacunes persistent. Ce cas le prouve.
Oui, et la justice se retrouve souvent à colmater les brèches. Pas idéal.
Les concubins n’ont pas les mêmes devoirs, donc pas les mêmes droits. Cette logique semble difficile à contredire.
Certes, mais quand des enfants sont impliqués, la situation devient plus complexe.