Listen to the article
Une équipe de chercheurs en neuroscience et en biologie cellulaire de l’université Yale (Etats-Unis) a levé une part du mystère concernant le fonctionnement des neurones soumis à un fort stress. Sa recherche, réalisée in vivo sur le ver Caenorhabditis elegans, montre que les neurones peuvent eux-mêmes stocker de l’énergie sous forme de glycogène, une macromolécule de la famille des glucides. Cette sorte de batterie de secours est « utilisée directement comme source de carburant autonome », explique le neuroscientifique Daniel Colón-Ramos, principal auteur de l’étude publiée dans PNAS.
Seconde découverte, « ce processus est essentiel pour maintenir le recyclage des vésicules synaptiques », ces petites poches situées au bout des neurones qui transportent les messages chimiques et permettent la communication cérébrale. Ces résultats fondamentaux, poursuit le chercheur, confirment que « le choix du carburant neuronal, ici le glycogène, soutient la résilience du cerveau et pourrait être exploité scientifiquement pour comprendre l’apprentissage, la mémoire et les maladies ».
L’équipe souligne avoir dû surmonter deux principaux défis pour obtenir, au bout de cinq ans, ces résultats : mesurer les transformations chimiques et biologiques à l’échelle de neurones uniques d’un animal vivant ; séparer, ensuite, à l’aide d’outils génétiques, les contributions énergétiques autonomes des neurones de celles des astrocytes, cellules gliales jusqu’alors identifiées comme leurs principales sources d’énergie.
« Fonctionnement sophistiqué »
Daniel Colón-Ramos reconnaît avoir été surpris par la direction qu’ont prise ces travaux. « Nous nous attendions à ce que le glycogène joue un rôle indirect dans les neurones. Au lieu de cela, nous avons constaté que sa dégradation est cruciale pour que le neurone puisse adapter son fonctionnement face au stress. » Autre surprise, poursuit-il, « les neurones basculent de manière flexible entre des modes dépendants ou indépendants du glycogène. Cela montre à quel point leur fonctionnement peut être sophistiqué dans l’utilisation des sources de carburant afin de préserver leur fonction ».
Il vous reste 45.01% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



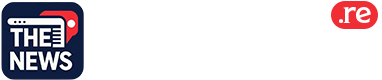
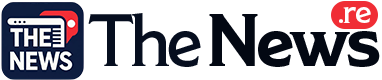
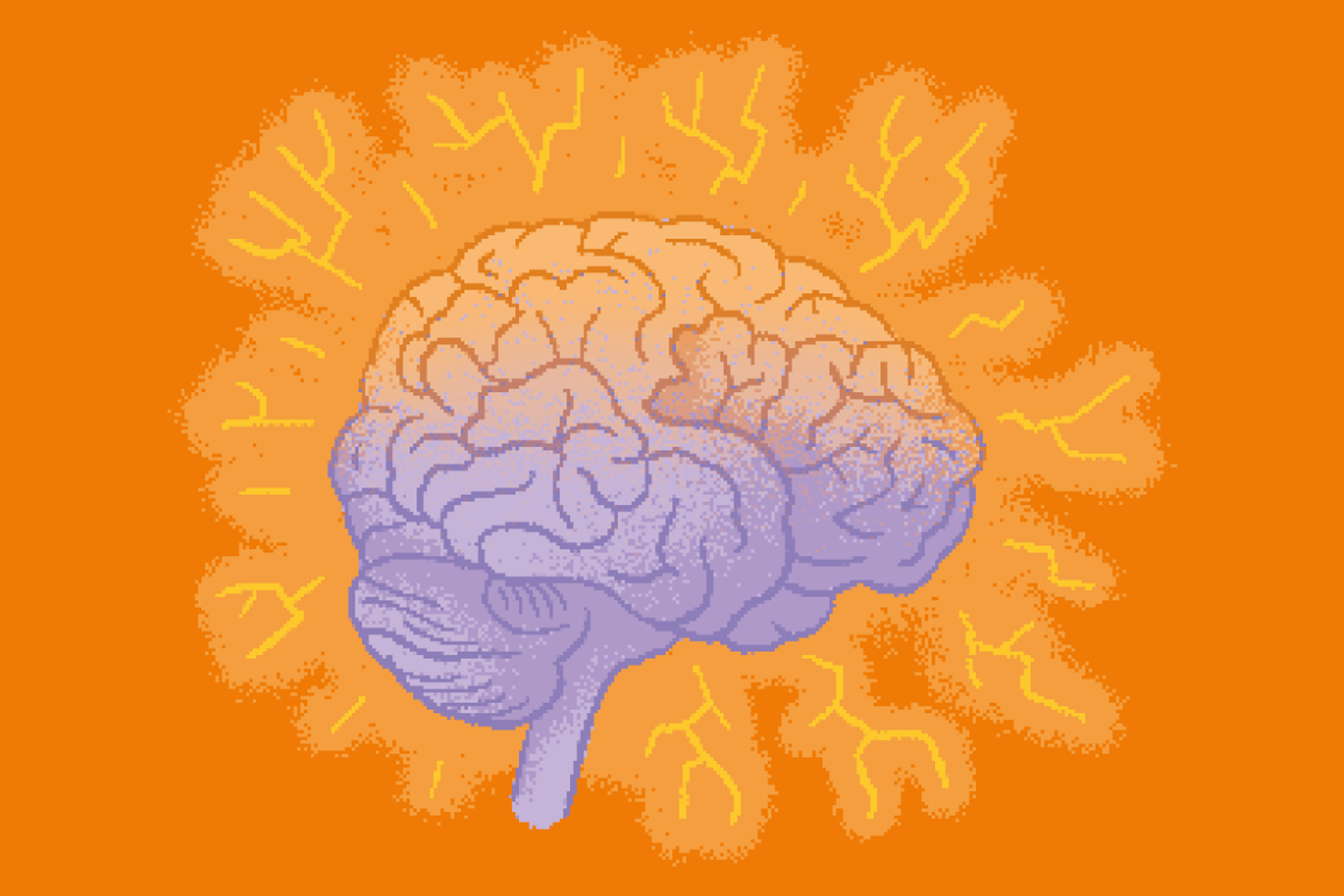

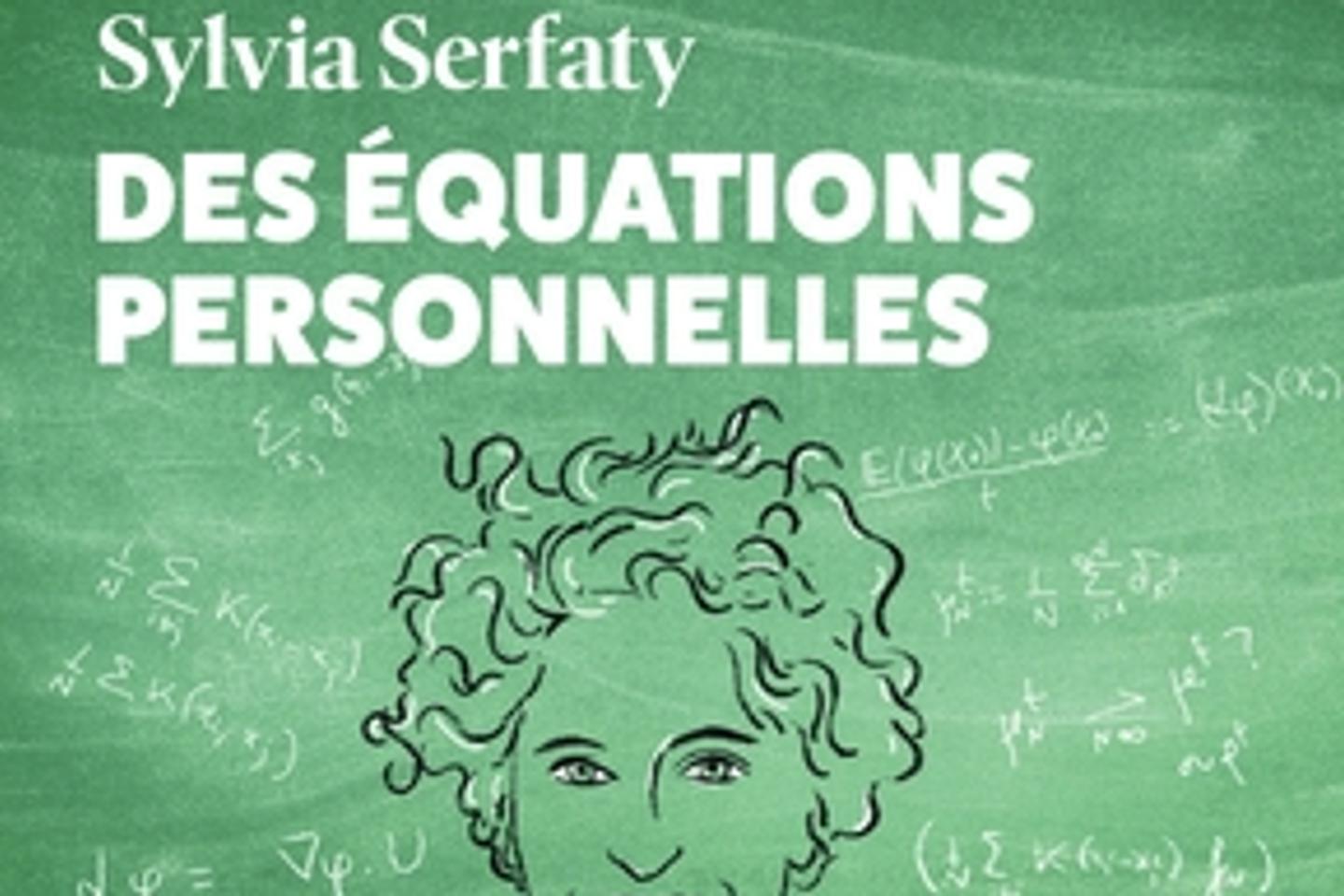
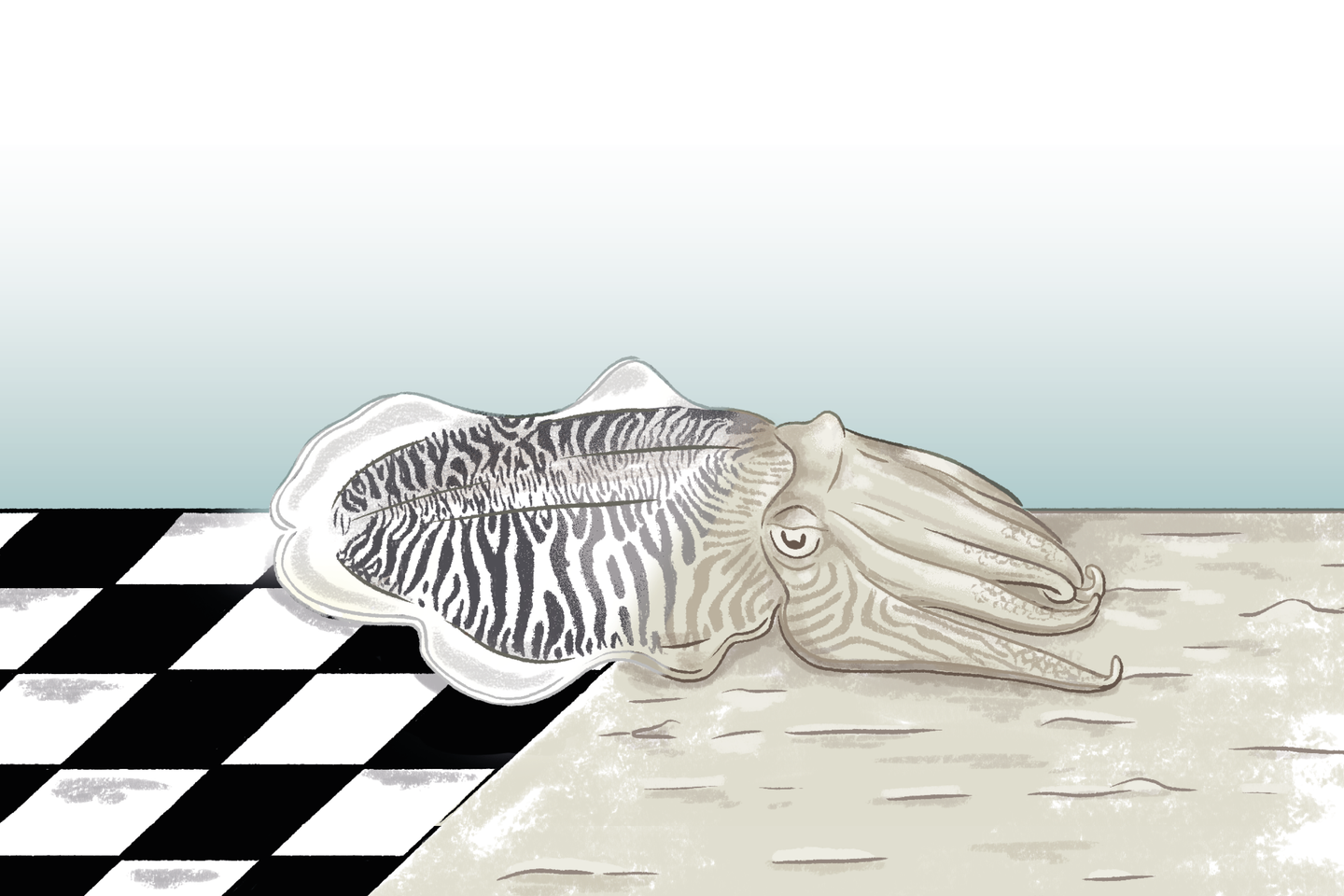



15 commentaires
Intéressant, mais comment sachant que les neurones stockent du glycogène pourrait-on explorer cela pour améliorer les performances cognitives ?
C’est une excellente question, peut-être que des cibles thérapeutiques pourraient être développées pour optimiser ce processus.
Si le glycogène est si important, pourrait-on envisager des compléments alimentaires pour stimuler cette « batterie de secours » ?
C’est une idée, mais il faudrait d’abord comprendre les mécanismes exacts pour éviter tout effet secondaire.
Fascinant de découvrir que les neurones ont leur propre système de stockage d’énergie ! Cela pourrait avoir des implications énormes pour la compréhension des maladies neurodégénératives.
Absolument, et c’est passionnant de voir que même les vers comme le C. elegans peuvent nous révéler ces mécanismes complexes.
On se demande si cette découverte pourrait un jour mener à des thérapies pour les troubles liés au stress chronique.
Je ne suis pas convaincu qu’une macromolécule comme le glycogène puisse jouer un rôle aussi crucial dans le fonctionnement neuronal. Il faudrait plus de preuves.
La publication dans PNAS suggère que les preuves sont solides, mais vous avez raison, des recherches supplémentaires seront nécessaires.
Cinq ans d’étude pour ces résultats, ça montre à quel point la recherche en neuroscience est exigeante et délicate. Félicitations à l’équipe !
Le détail et la précision sont indispensables dans ce domaine, chaque découverte compte.
Cette découverte pourrait-elle un jour aider à traiter les addictions ou les troubles de l’humeur ? Les neurones sous stress y jouent un rôle, non ?
Toutes les pistes sont bonnes à explorer, surtout dans un contexte où le stress neuronal est impliqué dans de nombreuses pathologies.
Cette étude ouvre des perspectives prometteuses pour la médecine régénérative. Les neurones ne sont pas aussi vulnérables qu’on ne le pensait.
Effectivement, cela pourrait changer notre approche des traitements pour les lésions cérébrales.