Listen to the article
Livre. Peut-on écrire en plein génocide ? C’est la question que se pose dès la première page de son livre, La mort est en train de changer (Les Liens qui Libèrent, 112 pages, 12 euros), l’écrivaine libanaise Dominique Eddé. Le faire est une « épreuve à la limite de l’obscénité ». Renoncer alors qu’on en a la possibilité est « encore moins glorieux ». Plus loin, elle y revient : « N’en sommes-nous pas au point où parler pour rien vaut mieux que se taire sur tout ? » Alors autant parler, et donc écrire, car « Gaza est aujourd’hui le point culminant de l’inconcevable accepté, de la tragique défaite de l’humanité ».
Dans ce petit livre dont la grandeur ne se mesure pas au nombre de pages, Dominique Eddé s’efforce de penser ce qui est à l’œuvre dans la bande de Gaza et, plus généralement, dans le monde. C’est un essai dans les deux sens du terme, donc aussi une tentative, un geste, une parole contre l’oubli et l’écrasante fatalité de l’actualité. La pensée de Dominique Eddé se développe par associations d’idées, parenthèses, tête-à-queue, pour finir par fixer une image nette et saisissante de la difformité du monde. Elle mêle choses lues, vues, réflexions éparses et rencontres passées. Jankélévitch, Nietzsche, Kafka y font des apparitions. Avec un souci constant : écouter la pensée plutôt que l’intelligence. Car l’intelligence a beaucoup servi à étouffer, à museler les esprits.
Dominique Eddé, qui se présente comme une « spécialiste de rien, sinon du vertige d’où procède la pensée », est une pessimiste qui se soigne. C’est ce pessimisme qui lui fait juger « illusoire, voire infantile » le « plus jamais ça » d’après la seconde guerre mondiale. C’était ignorer la nature humaine et ses instincts profonds. Il suffisait pourtant d’avoir lu Dostoïevski pour « comprendre qu’une victime peut se retourner en monstre, en un rien de temps. Et l’inverse », écrit-elle. Seule l’introspection nous sauvera de la répétition interminable de l’innommable : « Travailler à comprendre, c’est faire connaissance avec les monstres qui dorment en nous. »
Il vous reste 63.46% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



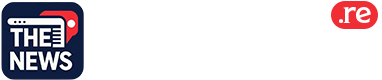
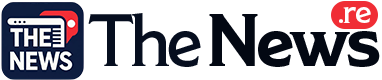
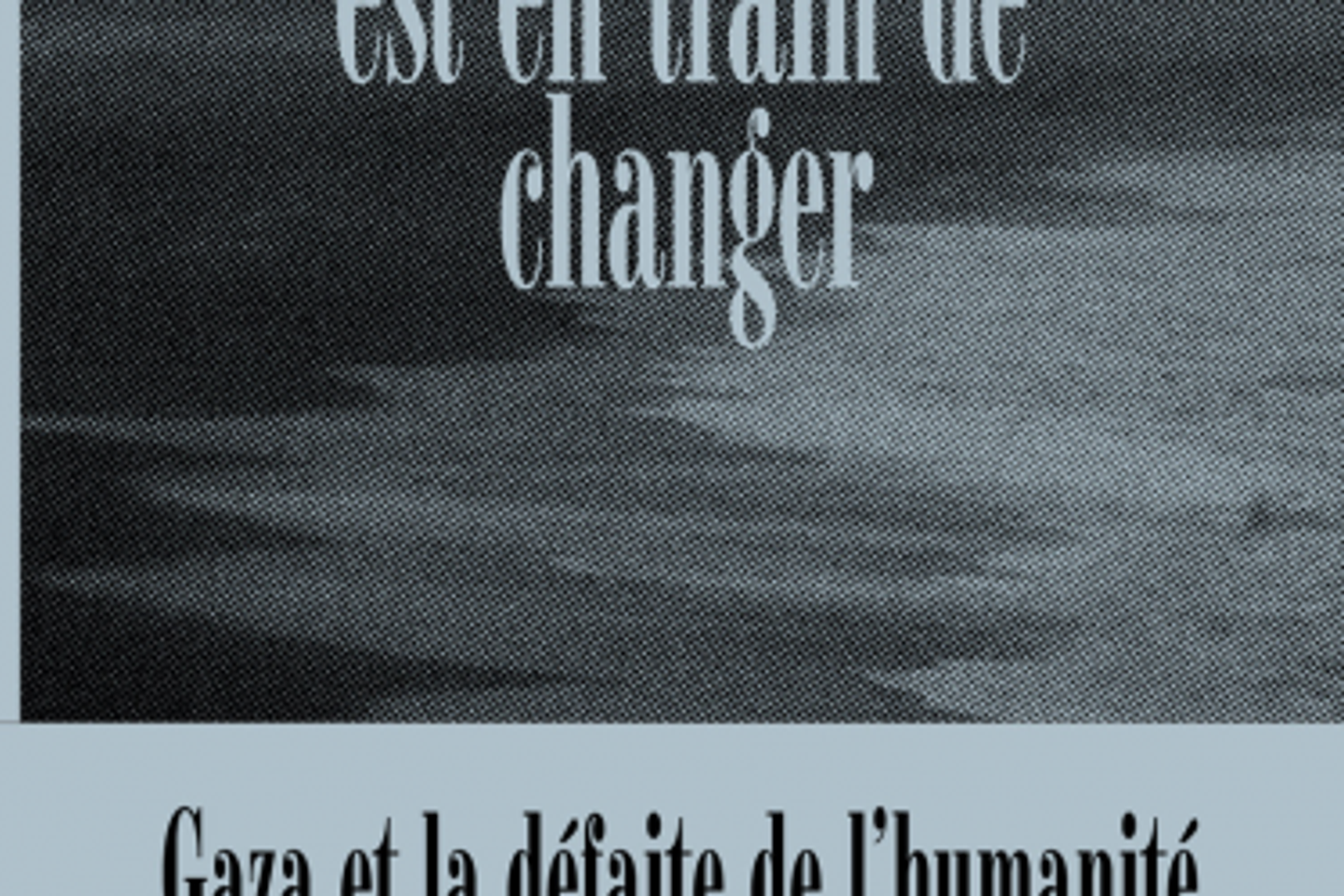





13 commentaires
Ce livre semble aborder des sujets profonds et dérangeants. Comment l’écrivaine parvient-elle à concilier l’écriture avec l’horreur des événements à Gaza ?
Est-ce que cet essai propose des solutions, ou se concentre-t-il uniquement sur l’analyse de la situation ?
Le fait même d’écrire sur un tel sujet est un acte courageux, même si c’est une épreuve.
Dominique Eddé semble utiliser l’écriture comme une arme contre l’oubli et la fatalité. Son approche associative est-elle efficace pour transmettre sa pensée ?
Peut-être que cette méthode reflète justement la complexité et l’incohérence des événements qu’elle décrit.
Je suis intrigué par la mention de Gaza comme point culminant de l’inconcevable. Est-ce que cet essai pourrait donner des clés pour mieux comprendre les enjeux actuels ?
C’est une question importante, surtout dans un contexte où la désinformation est rampante.
La tragédie humaine décrite dans cet essai est à la fois universelle et profondément enracinée dans un contexte spécifique. En quoi cela influence-t-il la portée du message ?
C’est peut-être cela qui rend ce livre particulièrement pertinent aujourd’hui.
La question de savoir si l’on peut écrire pendant un génocide est vraiment poignante. Cela souligne la difficulté de l’art dans des contextes d’une telle barbarie.
L’écriture devient-elle alors un devoir moral, une responsabilité face à l’indifférence ?
Écrire sur la mort et la destruction doit être une tâche extrêmement difficile. Comment l’auteure parvient-elle à garder une forme de clarté malgré l’ampleur du sujet ?
Cela doit nécessiter un équilibre délicat entre émotion et réflexion.