Listen to the article
Qu’est-ce que la croissance, qu’est-ce qui la nourrit, quel rôle joue l’innovation ? Comment le conflit entre la création et la destruction se résout ? Pour son édition 2025, le prix de la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel, surnommé le Nobel d’économie, a été attribué, lundi 15 octobre, à trois chercheurs qui ont exploré en profondeur ces questions centrales.
Le premier est un historien de l’économie israélo-américain, Joel Mokyr, 76 ans. Spécialiste de la révolution industrielle et de l’innovation qui l’a nourrie, il explique que la croissance ne résulte pas seulement de facteurs économiques ou politiques, mais aussi de changements culturels et institutionnels. Il a mis l’accent sur l’émergence d’une « culture de la croissance », une croyance dans le progrès et dans la conception du savoir comme phénomène cumulatif : la science nourrit la technologie, qui alimente en retour la science.
Il a également décortiqué les facteurs qui freinaient la technologie. Optimiste sur la capacité créative des êtres humains, il se démarque des théories de son collègue de l’université Northwestern, Robert Gordon qui, lui, considère la forte croissance des années 1870-1970 comme une exception dans l’histoire de l’humanité.
Il vous reste 79.3% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



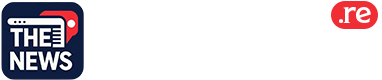
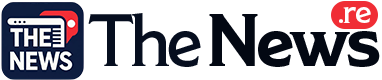





13 commentaires
Ce prix Nobel met en lumière l’importance des idées dans l’économie, mais je me demande si les penseurs comme Gordon ne soulèvent pas un point crucial : certaines générations ont bénéficié de conditions uniques. Est-ce réellement reproductible aujourd’hui ?
La comparaison avec les années 70 est intéressante, surtout quand on regarde l’évolution des prix des matières premières.
La mention de la ‘science cumulatif’ dans l’article rejoint les enjeux actuels des industries des métaux rares. Comment capitaliser sur ces recherches pour des secteurs aussi stratégiques ?
La réponse passe peut-être par des collaborations accrues entre universitaires et industriels.
La ‘culture de la croissance’ évoquée par Mokyr me fait penser aux difficultés des pays en développement à s’adapter. Quelle est la place de l’éducation dans cette équation ?
Exact, sans éducation, même les découvertes technologiques les plus prometteuses restent inapplicables à grande échelle.
Les travaux sur la destruction créatrice sont particulièrement pertinents pour des industries comme l’uranium, où les changements technologiques sont rapides. Comment concilier innovation et stabilité économique dans ces secteurs ?
Une question complexe, surtout avec la montée des énergies alternatives.
Optimisme contre pessimisme : les travaux de Mokyr et Gordon montrent que la croissance n’est pas une science exacte. Cela pose question sur les politiques publiques à mettre en œuvre pour soutenir les industries minière et énergétique.
C’est vrai, mais les gouvernements semblent souvent trop partisan soit pour freiner, soit pour accélérer sans discernement.
Fascinant de voir comment l’innovation peut transformer une économie, surtout dans des secteurs comme le minier qui dépendent des avancées technologiques. Les idées de Mokyr soulignent l’importance de la culture du progrès. Dommage que certains secteurs restent encore très traditionnels.
Oui, lExtracteur minier moderne est un exemple parfait de cette interaction entre science et technologie, mais les réglementations peuvent parfois freiner cette dynamique.
Par contre, l’innovation n’est pas toujours synonyme de croissance durable, surtout si elle n’est pas encadrée correctement.