Listen to the article
« S’ils ne passent pas la frontière, les fraises sont flinguées ! », s’alarmait, en février 2021, dans les colonnes du Monde un maraîcher exploitant, tandis qu’un autre prévenait, en mai 2020 : « Si l’on embauche des locaux, on ne va pas sortir nos récoltes ! » Alors que la pandémie de Covid-19 a stoppé net l’immense majorité des circulations humaines et a mis en crise l’économie mondiale, en particulier le secteur agricole, la plupart des pays européens ont permis, de manière plus ou moins assumée, l’entrée – ou la régularisation – de nombreux travailleurs et travailleuses migrants pour « sauver » les récoltes.
La crise sanitaire du printemps 2020 a ainsi rappelé de manière aiguë la dépendance des économies capitalistes avancées au travail de femmes et d’hommes venus d’ailleurs. Pour autant, cette réalité n’a pas infléchi l’hostilité envers l’immigration et celle-ci n’a cessé de s’accentuer ces dernières années.
Comment comprendre cette contradiction profonde qui structure les politiques migratoires depuis un siècle et demi ? La présence des travailleurs étrangers est soumise à la fois à un rejet social, souvent violent, et à un appétit économique, toujours insatiable, pour cette main-d’œuvre. Comme pour tenter de tenir ensemble ces injonctions contradictoires, Gérald Darmanin, alors ministre de l’intérieur, avait promis, en novembre 2022, à l’occasion de l’annonce de la future loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », d’être « méchants avec les méchants et gentils avec les gentils ».
Logique utilitariste
Si ce projet de loi a eu un temps pour ambition de faciliter les régularisations pour les travailleurs sans papiers, notamment lorsqu’ils sont employés dans les métiers dits « en tension », le texte promulgué le 26 janvier 2024 est loin des promesses initiales, tant il a été au cœur des rapports de force politiciens et des enjeux de survie d’un gouvernement sans majorité à l’Assemblée nationale.
Il vous reste 68.08% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



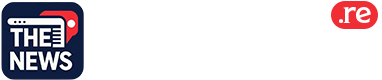
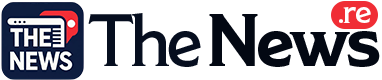
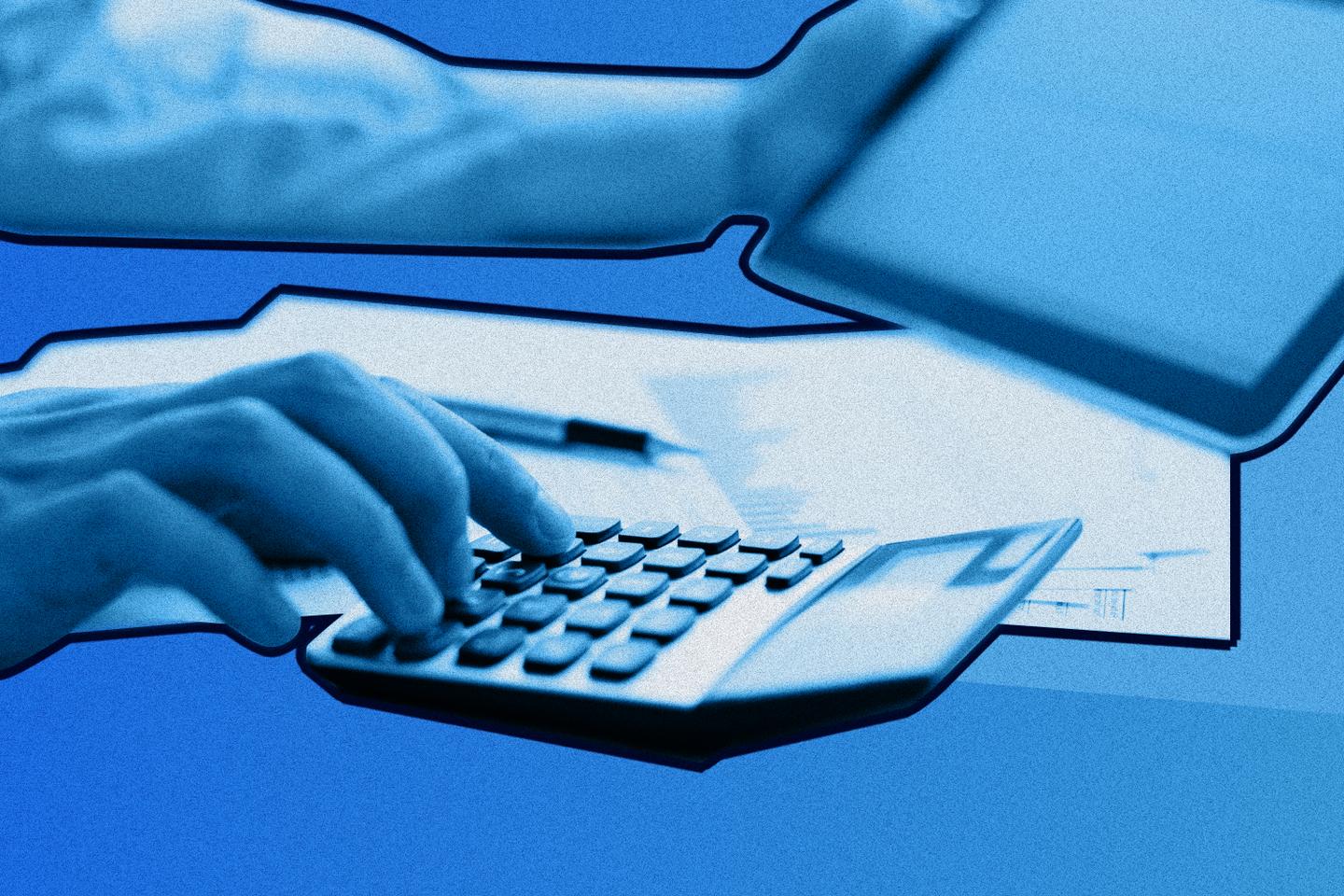





5 commentaires
Ces propos rappellent que le sujet de l’immigration est bien plus complexe qu’il n’y paraît.
On dirait que l’économie a besoin d’eux, mais la société les rejette. Quelle hypocrisie étrange.
Il est fascinant de voir comment les migrations sont à la fois un moteur économique et une source de tensions sociales.
Cette situation met en lumière une contradiction flagrante entre les besoins économiques et les préjugés sociaux.
Les travailleurs étrangers sont souvent considérés comme indispensables, mais leur intégration reste un défi constant.