Listen to the article
Dans une lettre à la ministre de l’éducation Linda McMahon rendue publique, vendredi 10 octobre, la présidente du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sally Kornbluth, a refusé, de signer un accord sur les priorités de l’administration Trump en matière d’éducation supérieure.
« Le document inclut des principes avec lesquels nous ne sommes pas d’accord, dont certains qui restreindraient la liberté d’expression et notre indépendance en tant qu’institution », a-t-elle écrit pour justifier son refus.
La proposition du gouvernement américain requiert notamment des universités qu’elles excluent des facteurs tels que « le sexe, l’ethnicité, la race, la nationalité, les opinions politiques, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les affiliations religieuses » de leurs processus d’admission des étudiants, d’attribution des bourses et de recrutement du personnel.
Elle leur demande aussi d’adhérer aux définitions « biologiques » du « masculin » et du « féminin », pour l’accès aux toilettes ou aux compétitions sportives, ainsi que de « réviser leurs structures de gouvernance » afin d’empêcher une « idéologie dominante » et de « transformer ou abolir les institutions qui punissent, rabaissent et même incitent à la violence contre les idées conservatrices ».
Pressions croissantes sur les universités américaines
Ces demandes du gouvernement Trump ont également été envoyées aux universités d’Arizona, de Pennsylvanie, de Californie du Sud, du Texas et de Virginie, à Brown, Dartmouth et Vanderbilt. MIT est la première université à avoir rejeté cet accord, les huit autres n’ont pas encore donné leur réponse, attendue avant le 20 octobre.
Si les établissements sont « libres » de ne pas souscrire à ces principes, ils « choisissent de renoncer [à des] avantages fédéraux » en matière de prêts étudiants, de subventions, de financement de la recherche ou encore de fiscalité.
Dans un communiqué, la porte-parole de la Maison Blanche, Liz Huston, a déclaré « toute université qui refuse cette opportunité unique de transformer l’enseignement supérieur ne sert ni ses étudiants ni leurs parents – elle s’incline devant des bureaucrates radicaux de gauche ».
Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain n’a cessé d’accentuer les pressions sur des universités comme Harvard ou Columbia, accusées d’antisémitisme pour avoir toléré en 2024 des manifestations propalestiniennes, notamment en gelant les subventions versées par l’Etat fédéral pour la recherche.



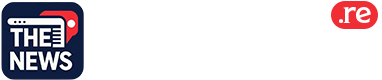
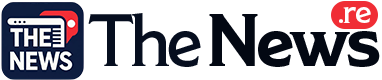




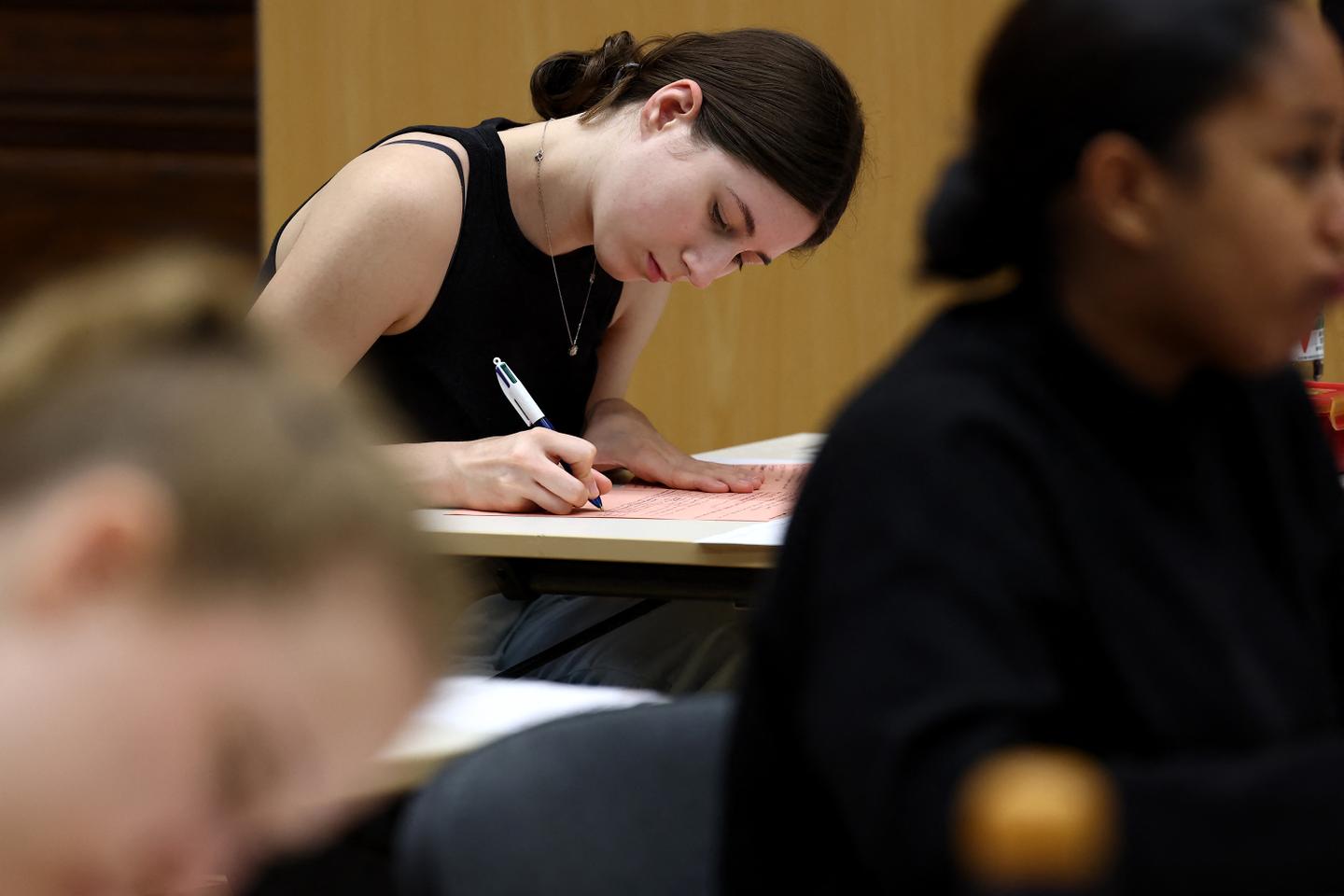

14 commentaires
Les universités doivent rester neutres politiquement pour garantir l’ouverture d’esprit.
Neutres, oui, mais pas indifférentes aux questions de justice sociale.
Quelles sont les conséquences si le MIT refuse les conditions inscrites dans cet accord?
Cela reste à voir, mais le MIT semble prêt à assumer les risques.
Un refus courageux, mais la pression politique peut être intense pour les institutions.
Vrai, surtout dans le contexte actuel.
Un geste symbolique ou une prise de position qui aura un impact réel? Difficile à dire.
Les symboles ont parfois plus de poids qu’on ne le pense.
Symbolique ou pas, c’est une déclaration forte.
L’éducation supérieure doit rester libre de toute idéologie imposée par un gouvernement.
Totalement d’accord, l’université est un espace de débat et de réflexion libre.
Intéressant que le MIT refuse cet accord. Un signal fort pour la liberté académique?
Certainement, ça pourrait inspirer d’autres universités à prendre position.
Mais quelles seraient les conséquences concrètes pour le MIT?