Listen to the article
L’historiographie de l’empire colonial français a longtemps oscillé entre le récit idyllique de l’apport des bienfaits de la civilisation aux peuples « arriérés » et le récit dramatique de l’exploitation impitoyable des peuples opprimés. Comment concilier les principes inscrits au fronton des mairies de la République, « liberté, égalité, fraternité », avec la réalité brutale de la colonisation ? C’est la conquête militaire d’Etats indépendants (régence d’Alger, empires d’Annam et du Mali, royaume de Loango…), et non de « tribus sauvages », qui permet à la France de constituer le deuxième empire colonial du monde.
La « science » anthropomorphique théorise une hiérarchie raciale où trône à son sommet la race blanche, tandis que les expositions coloniales, les récits des explorateurs et les exploits des troupes coloniales popularisent cette différence d’humanité dans les représentations culturelles des Français, jusqu’aujourd’hui encore. Une inégalité entérinée en 1881 par le code de l’indigénat, qui crée un statut juridique inférieur pour les « sujets » de l’Empire – il en comptera 60 millions à son apogée – alors que les colons européens sont citoyens.
Il vous reste 86.37% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



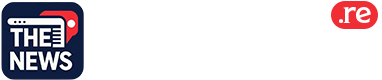
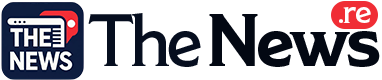


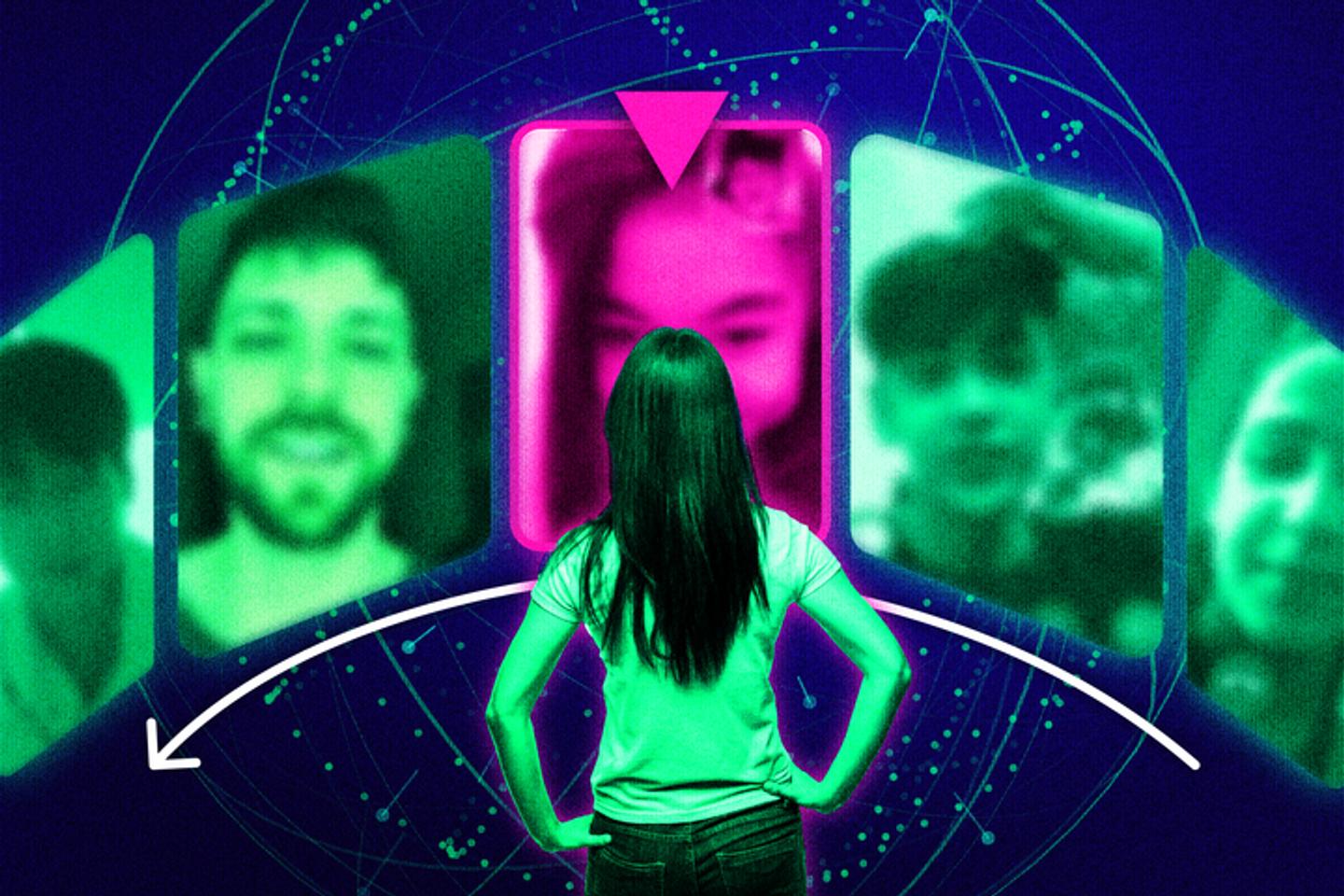




10 commentaires
La France doit faire face à son passé colonial avec lucidité. Mais est-il possible de réparer des siècles d’injustices ?
La conquête coloniale n’était pas seulement militaire, mais aussi culturelle et psychologique. Un héritage encore lourd à porter.
Le code de l’indigénat est un exemple flagrant des inondations idéologiques de l’époque. Ces pratiques ont-elles influencé les politiques modernes des anciennes puissances coloniales ?
Un sujet complexe qui mérite une réflexion approfondie. La colonisation a laissé des traces profondes, tant sur le plan économique que culturel. Comment ces blessures se cicatrisent-elles aujourd’hui ?
Les expositions coloniales ont joué un rôle dans la construction d’un discours racialiste. Leur impact persiste-t-il dans les mentalités contemporaines ?
Les théories raciales du XIXe siècle sont choquantes par leur absurdité. On dirait des fables, et pourtant, elles ont modelé des sociétés entières.
Pourquoi ne parle-t-on pas davantage des résistances locales face à la colonisation ? Ces récits alternatifs pourraient enrichir la compréhension historique.
Les principes de la République ont-ils été un outil de domination ou une aspiration jamais réalisée ?
L’article soulève des questions cruelles. Comment les nations colonisées considèrent-elles cette période aujourd’hui ?
Quelle ironie de voir la France exporter les valeurs de liberté, tout en imposant un système d’oppression. L’histoire n’est pas toujours linéaire.