Listen to the article
En politique, être nommé est une longue patience. Démissionner, en revanche, est un art. On peut le dire autrement : ce qu’exige d’obstination l’accession aux responsabilités est précisément ce qui sert le moins quand sonne l’heure du départ. Là, il convient de trancher, de prendre son risque, de choisir son moment – le kairos – et les arguments qu’il induit pour que la démission ne soit pas la figure d’une fuite ou d’un plat renoncement.
Comme souvent, c’est de Gaulle qui sert de modèle. Celui de 1969. Sa démission n’a rien d’un coup de tête. C’est une mise en scène sous contrôle. De Gaulle choisit de convoquer un référendum. Il choisit d’annoncer qu’une réponse négative entraînera sa démission immédiate. Il choisit Colombey-les-Deux-Eglises, son village de Haute-Marne, plutôt que l’Elysée quand il constate que le peuple ne l’a pas suivi. Il perd, sans doute, mais jusqu’au bout, il conserve sa liberté. Même vaincu, il reste maître du jeu. Il peut ainsi rentrer définitivement dans l’histoire, en majesté.
Cette capacité de contrôle est précisément ce qui fait aujourd’hui défaut à Emmanuel Macron. C’est qu’il lui manque – outre le caractère, mais c’est une autre affaire – deux cartes qui pourraient encore le sauver : l’idée du désert et de la solitude, visiblement, le terrifie et la remise en jeu de son mandat lui est constitutionnellement interdite. Il ne veut pas partir avant la fin de son quinquennat. Il entend résister. Il se place ainsi dans une situation où il peut être contraint de démissionner. Il y a là une vieille loi qu’il semble ignorer : en politique, on ne fait pas ce qu’on veut mais ce qu’on peut. Sauf à être de Gaulle, ce qui, on en conviendra, ne s’improvise pas du jour au lendemain.
Deux exigences contradictoires
La démission présidentielle, en ce qu’elle a d’exceptionnelle et partant, de nécessairement théâtrale, diffère de la démission ministérielle sans que, pour autant, cette dernière exige des qualités de flair et de maîtrise d’une nature particulière. Là encore l’actualité la plus chaude quand on la met en regard de l’histoire politique, permet de mieux comprendre. Bruno Retailleau, par exemple, puisqu’il est l’acteur principal du dernier épisode du chaos. A-t-il démissionné, au soir du dimanche 5 octobre ? A proprement parler, non. Mais, en pratique, il a fait tomber un gouvernement dans lequel il venait d’être reconduit à une place éminente.
Il vous reste 61.28% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
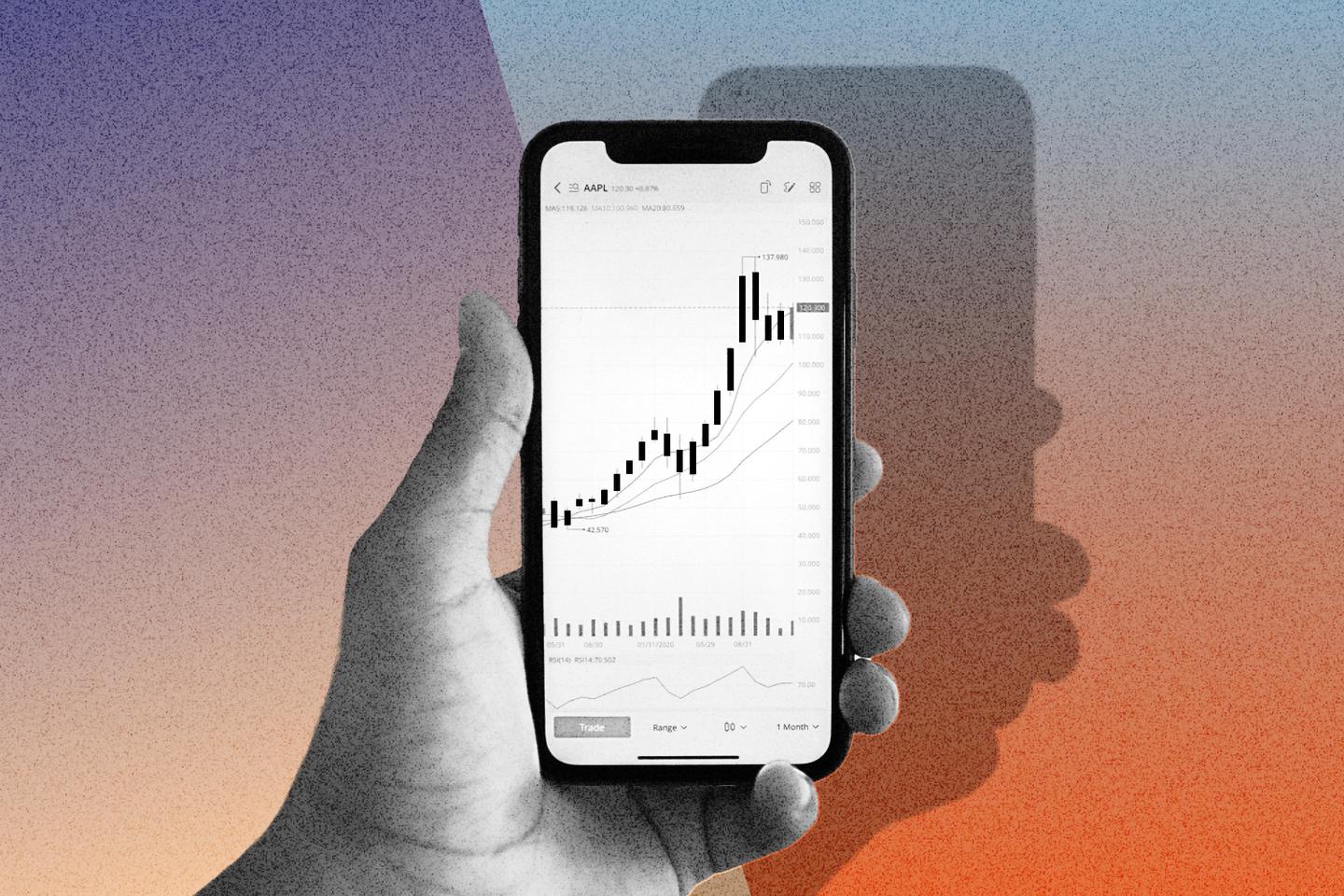
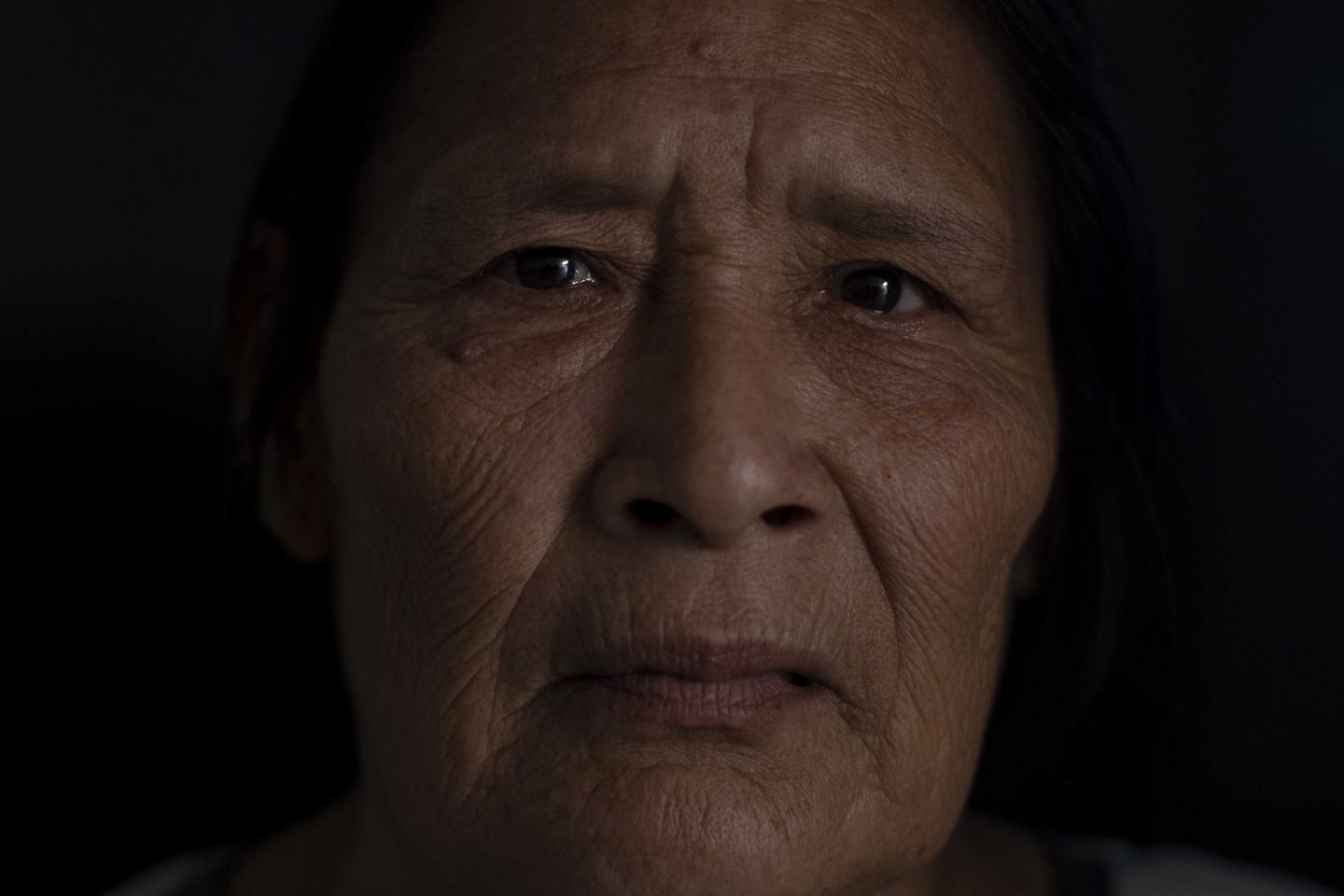

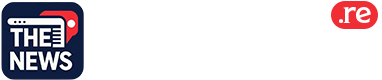
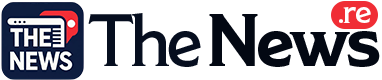







23 commentaires
Macron semble manquer de cette maîtrise des événements. La comparaison avec de Gaulle est frappante.
C’est une question de tempérament et de vision à long terme.
Un bon départ peut laisser une meilleure impression qu’un mandat terminé en désordre.
C’est certain, surtout dans un monde médiatique aussi exigeant.
La démission est un art, mais elle doit être réfléchie. Comme le dit l’article, il faut choisir le bon moment.
Exactement, c’est une question de timing et d’image.
Pourtant, certains partis en font un argument de désunion.
De Gaulle a marqué l’histoire par sa sortie. Macron aurait-il les moyens de faire de même ?
Difficilement, vu les divisions actuelles.
La comparaison avec de Gaulle est pertinente, mais les époques ont changé.
Les outils de communication ont évolué, mais les principes restent les mêmes.
Pourquoi certains politiques ont-ils tant de mal à partir ? La peur de l’oubli peut-être.
C’est une question complexe, liée à l’ego et à la stratégie.
Ou la peur de perdre le pouvoir et les privilèges.
Le kairos, ou le bon moment, est essentiel dans la démission. De Gaulle l’a compris.
Trouver ce moment est une science politique à part entière.
La démission de Macron serait-elle perçue comme une fuite ? Tout dépend de la manière dont elle est présentée.
C’est une question de communication et de légitimité.
Intéressant article sur la démission en politique. La façon dont de Gaulle a géré son départ est un exemple de stratégie et de contrôle.
Tout à fait d’accord. Macron pourrait s’en inspirer.
Mais est-ce que cela s’applique à tous les contextes politiques ?
La démission peut être un acte fort si elle est bien orchestrée. L’exemple du référendum de 1969 est édifiant.
Oui, mais il faut des circonstances exceptionnelles.