Listen to the article
Guillaume Prévost, nouveau secrétaire général de l’enseignement catholique, a déclaré qu’il fallait « redonner clairement le droit à une enseignante de faire une prière le matin avec ses élèves, parce que c’est le cœur de [leur] projet ». Cette déclaration pose une question cardinale : quelle est l’identité de l’enseignement catholique ?
Le projet catholique est défini dans ses statut, réécrits en 2013. Outre « travailler à faire connaître la bonne nouvelle du salut » (article 8), « l’école catholique est une école pour tous. Elle porte une attention plus particulière à toutes les formes de pauvreté (…), surtout aux plus pauvres et aux marginaux » (article 38). En 2014, de façon cohérente avec ce projet, l’enseignement catholique se donne pour objectif de « renforcer l’accueil de toutes les fragilités et [de] favoriser le développement de la mixité sociale ». Dans sa présentation des « moyens affectés à la mixité sociale et scolaire », l’enseignement catholique précise qu’il « poursuit une politique volontariste en faveur des publics en difficulté » (2024). Au-delà de ces statuts et des actions mises en œuvre, quelle est la réalité sociologique des établissements catholiques, qui scolarisent 96 % des élèves inscrits dans les établissements privés sous contrat ?
Un indicateur de la « politique volontariste en faveur des publics en difficulté » de l’enseignement catholique est la proportion d’élèves inscrits dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), dont l’objet est la scolarisation des élèves en situation de handicap. Alors que l’enseignement privé sous contrat scolarise plus de 20 % des élèves du secondaire, il ne scolarise que 9,3 % des élèves inscrits dans les ULIS (contre 90,7 % pour le public), selon l’édition 2025 des « Repères et références statistiques » (RERS) du ministère de l’éducation nationale.
Il vous reste 69.03% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



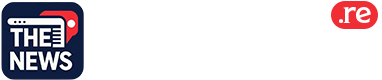
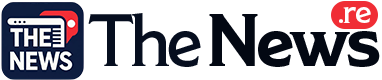





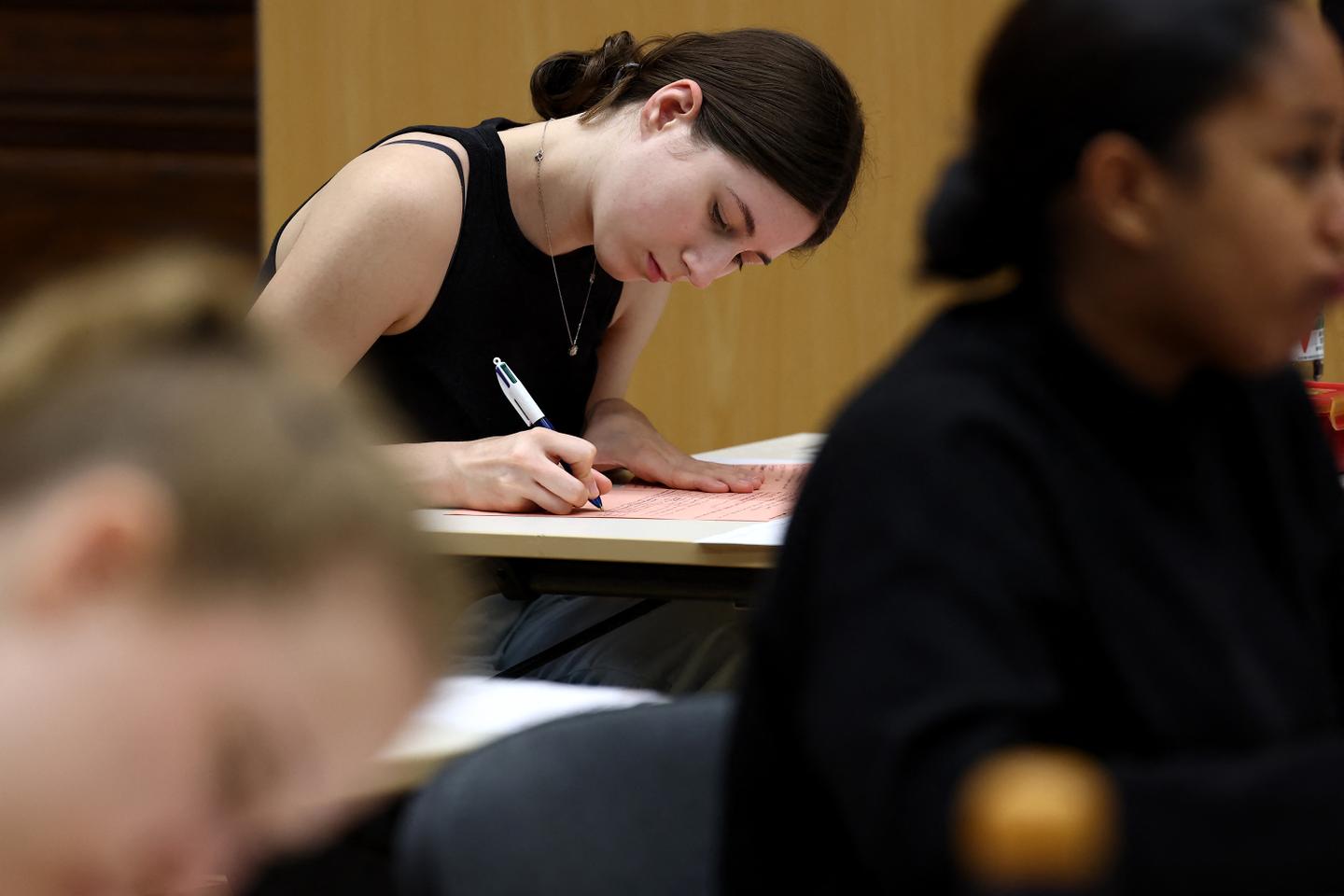
13 commentaires
Une déclaration qui soulève des questions sur la place de la religion dans l’enseignement. Comment concilier foi et laïcité dans un cadre scolaire?
L’important est de respecter les convictions de chacun tout en assurant un enseignement équilibré.
C’est un débat complexe, surtout dans une société de plus en plus diverse.
Redonner le droit à une prière le matin me semble rétrograde. Le projet éducatif ne devrait-il pas primer sur les pratiques religieuses?
La liberté religieuse est un droit fondamental, mais elle doit s’exercer dans le respect des autres.
Intéressant de voir comment l’enseignement catholique évolue pour mieux inclure les publics fragiles. Et les résultats concrets, sont-ils à la hauteur des ambitions?
L’accessibilité reste un enjeu majeur dans de nombreux établissements.
Les chiffres montrent une progressedans certains domaines, mais il reste du travail.
Quelle est la marge de manœuvre des enseignants aujourd’hui face à ces enjeux sociologiques et religieux?
Un équilibre délicat à trouver entre tradition et modernité.
Elle dépendra largement des directives nationales et des valeurs locales.
L’enseignement catholique a-t-il assez de moyens pour réellement renforcer la mixité sociale, comme il le prétend?
Les financements publics sont importants, mais les défis restent nombreux.