Listen to the article
Quatre-vingts ans après la création de la Sécurité sociale, l’ambiance n’est pas à la célébration festive. Les voix invitant les pays européens à restreindre leur Etat social afin de construire un Etat de guerre se multiplient, suggérant que l’arbitrage entre dépenses sociales et militaires serait un jeu à somme nulle. En France, le débat se concentre de manière obsessionnelle autour des économies, en présentant les crises de financement comme le résultat d’un système pervers dès son origine. Un retour sur la généalogie intellectuelle de la « Sécu » s’avère donc intéressant pour comprendre les choix qui l’ont façonnée.
Choisi dès 1944 pour désigner les objectifs du Conseil national de la Résistance, le concept de Sécurité sociale, qui remonte à l’époque des Lumières, vient alors de connaître un énorme succès à l’échelle mondiale. Porté par la réponse politique à la crise des années 1930 et par la mobilisation contre le nazisme, il renvoie à la nécessité de garantir à celles et ceux qui dépendaient uniquement de leur travail un horizon de prévisibilité pour bâtir leur existence.
Popularisée par les réformes de Franklin D. Roosevelt aux Etats-Unis [président de 1933 à sa mort, en 1945], la Sécurité sociale devient la promesse d’un monde à l’abri du besoin et de la peur, la garantie d’une future paix durable. Alors que le conflit mondial fait rage, c’est sur ce projet d’avenir que les pays des Nations unies s’appuient pour mobiliser leurs citoyens, en pointant l’horizon d’une société plus équitable pour laquelle il vaut la peine de se battre.
En 1945, l’architecte de la Sécurité sociale française, Pierre Laroque [1907-1997], mobilise ces références. Aux aides uniformes ne garantissant que le minimum vital – préconisées par le rapport parlementaire britannique dit Beveridge, en 1942 – le haut fonctionnaire oppose la « vérité sociale » de la formule américaine, celle du New Deal, qui prévoit des prestations proportionnelles au revenu, dans la limite d’un plafond : en découle la généralisation des assurances sociales, offrant un revenu de remplacement aux ménages touchés par la maladie, par le chômage ou par la vieillesse. Bien que confié aux partenaires sociaux, le système a vocation à couvrir toute la population, puisque, comme l’argumente le ministre communiste [du travail et de la Sécurité sociale] Ambroise Croizat [1901-1951], nul ne peut « être certain de se trouver dans une sécurité durable ».
Il vous reste 50.4% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



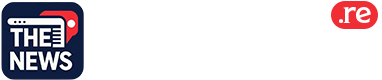
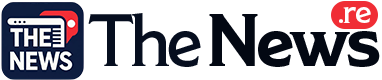







15 commentaires
La Sécurité sociale a été un projet visionnaire, mais aujourd’hui, les défis sont tout autres.
Oui, mais les valeurs de solidarité doivent être préservées.
Les économies à réaliser ne doivent pas mettre en danger les plus vulnérables.
La santé et la prévoyance sociale sont des enjeux cruciaux, surtout en période de crise.
Absolument, il faut éviter de sacrifier l’une pour l’autre.
Un retour sur l’histoire de la Sécurité sociale est pertinent, mais il ne faut pas oublier les contraintes économiques actuelles.
Tout à fait, mais les réformes doivent aussi prendre en compte les besoins humains.
L’équilibre entre dépenses sociales et militaires reste un débat complexe.
L’État social doit-il vraiment céder face aux pressions militaires ? C’est une question qui mérite d’être posée.
La société civile doit se mobiliser pour défendre ses acquis.
Les priorités doivent être clairement définies pour éviter les injustices.
Les débats actuels montrent que le sujet est loin d’être réglé, et un consensus semble difficile.
C’est regrettable, car la cohésion sociale en dépend.
Les comparaisons avec les réformes de Roosevelt sont intéressantes, mais le contexte actuel est très différent.
C’est vrai, mais certains principes de base restent valables.