Listen to the article
Dans le flot de crises qui monopolisent l’attention mondiale, Haïti a trop souvent été relégué au second plan, mais détourner le regard est devenu impossible. Près de 90 % de la capitale Port-au-Prince est aujourd’hui sous l’emprise des gangs, et plus de 1,3 million de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer.
Derrière ces chiffres se cachent des réalités brutales : des familles arrachées à leurs maisons, des enfants privés d’école, des femmes et des jeunes filles victimes d’une violence intolérable. Les viols sont désormais utilisés comme arme de terreur. Des écolières sont agressées simplement parce qu’elles essaient de se rendre à l’école.
Entre 2023 et 2024, ces violences ont été multipliées par dix. L’aide humanitaire, elle, reste dramatiquement insuffisante : à peine plus de 10 % des besoins sont aujourd’hui financés, soit le taux le plus bas au monde. Cette situation exige une mobilisation collective à la hauteur de l’urgence humanitaire et sécuritaire qui se joue sous nos yeux.
La crise haïtienne s’étend au-delà des frontières du pays. Port-au-Prince est devenue un carrefour de trafics d’armes et de drogue. Les gangs qui terrorisent la capitale s’approvisionnent à l’étranger, tandis que des réseaux criminels utilisent Haïti comme point de transit vers les Etats-Unis, les Caraïbes et l’Europe. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, près de 423 000 Haïtiens vivaient en 2024 hors de leur pays en tant que réfugiés ou demandeurs d’asile.
L’histoire récente l’a montré : aucun effondrement d’Etat ne reste sans conséquences. La chute de la Libye, en 2011, a déstabilisé le Sahel en offrant un refuge à des groupes djihadistes. La guerre civile en Syrie a déclenché, en 2015, une crise migratoire sans précédent en Europe, tandis que l’invasion de l’Ukraine, en 2022, bouleverse depuis plus de trois ans l’équilibre du continent. Haïti ne peut être considéré comme une tragédie lointaine. Son instabilité constitue déjà un enjeu régional et international majeur.
Il vous reste 59.33% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



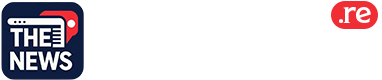
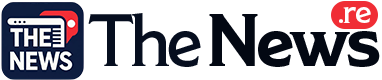





20 commentaires
Cette situation en Haïti est un rappel brutal de l’importance de la stabilité régionale. Les conséquences de cette crise pourraient affecter bien plus que la seule population locale.
Absolument, les réseaux criminels ne connaissent pas de frontières.
La montée en puissance des gangs en Haïti est une menace pour toute la région, les trafics ne s’arrêtent pas aux frontières.
C’est une crise qui nécessite une réponse régionale coordonnée.
La situation en Haïti est un exemple criant des conséquences de l’abandon des populations par leurs dirigeants.
C’est une leçon pour tous les pays où le pouvoir est déconnecté du bien commun.
Cette tragédie haïtienne pourrait-elle finalement pousser la communauté internationale à agir ?
On peut l’espérer, mais les promesses ne suffisent pas.
Le manque de soutien international pour Haïti est scandaleux. Comment peut-on laisser un pays sombrer ainsi ?
La priorité devrait être une intervention humanitaire massive.
Si même les écoles ne sont plus sûres, que reste-t-il comme espoir pour Haïti ?
L’éducation est pourtant la clé pour briser ce cycle de violence.
L’instabilité en Haïti est un nouvel aéroport pour la criminalité transnationale. La hausse des trafics est très préoccupante.
C’est une menace pour toute la région des Caraïbes et bien au-delà.
Cette crise montre à quel point les gangs ont pris le contrôle du pays. La situation semble désespérée.
C’est un échec flagrant des institutions haïtiennes et des pays voisins.
Les violations des droits humains en Haïti sont inacceptables. Comment la communauté internationale peut-elle rester silencieuse face à de telles atrocités ?
Le manque de financement pour l’aide humanitaire aggrave encore la situation.
Les chiffres sont accablants, mais où sont les solutions concrètes pour ramener la paix et la sécurité dans ce pays ?
La communauté internationale semble impotente, c’est le moins qu’on puisse dire.