Listen to the article
Avec la conclusion d’un cessez-le-feu permanent au Proche-Orient, la libération à venir des derniers otages israéliens et celle de prisonniers palestiniens, la perspective de la fin d’une guerre de deux ans à Gaza se précise enfin.
Cette guerre, proprement inouïe dans la longue histoire du conflit israélo-arabe, tant par le nombre colossal de victimes et de destructions de tous ordres que par sa durée, a touché les sociétés israélienne et palestinienne en plein cœur, et ces dernières mettront longtemps pour se relever après un tel déchaînement de violence.
Si on se concentre sur Israël, quels enseignements majeurs peut-on tirer ? En premier lieu, la société a montré – comme d’ailleurs la société gazaouïe – une indéniable résilience. Très vite, une fois surmonté l’effet de sidération après le 7-Octobre, un vaste mouvement de solidarité envers les familles d’otages s’est développé, dont le point de ralliement a été la « place des otages », en face du Musée d’art de Tel-Aviv.
Pour l’opinion publique, le retour des otages est demeuré l’objectif prioritaire, contrairement au premier ministre qui privilégiait, dans une course sans fin, l’affaiblissement militaire du Hamas.
Réfractaires à la réserve
En second lieu, si le consensus patriotique a été très fort au cours de l’année 2024, il s’est progressivement érodé par la suite. Un indice particulièrement révélateur a été la baisse de la motivation à servir dans la réserve. Alors que les réservistes ont massivement rejoint leurs unités au début de la guerre, ils n’étaient plus que 60 % à le faire ces derniers temps, ce qui commençait à poser des problèmes sur le plan opérationnel, selon un récent article du magazine + 972.
La plupart des réfractaires à la réserve le sont pour des raisons personnelles (et non politiques) : ils ne veulent tout simplement plus voir leur vie familiale et professionnelle perturbée par ces départs réguliers sur le champ de bataille. Les Israéliens ne veulent pas que leur pays devienne, comme le premier ministre Benyamin Nétanyahou l’a clamé, une « super Sparte », un Etat militarisé, sur le pied de guerre permanent.
Il vous reste 66.66% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



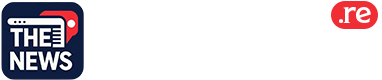
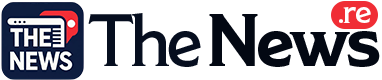







11 commentaires
On aimerait croire que ce cessez-le-feu marquera le début d’une réelle paix, mais l’histoire montre que ce ne sera pas aussi simple.
Cette guerre a laissé des traces profondes dans les deux sociétés. La reconstruction sera longue et difficile, même si un cessez-le-feu est signé.
Les impacts économiques seront énormes, surtout du côté palestinien.
La résilience démontre la capacité incroyable des populations à se serrer les coudes, même après des drames d’une telle ampleur.
La gestion du conflit par le gouvernement israélien sera sans doute largement discutée dans les mois à venir. Les critiques ne manqueront pas.
Deux ans de guerre changent une société à jamais. Les cicatrices, aussi bien physiques que psychologiques, prendront des décennies à guérir.
Les sociétés israélienne et palestinienne paieront longtemps le prix de ce conflit. Les conséquences sur les générations futures seront lourdes.
Le nombre de victimes et la destruction matérielle sont tout simplement terrifiants. Comment rebâtir dans de telles conditions ?
Espérons que cette fin de conflit permettra enfin un dialogue constructif entre les parties. La région a suffisamment souffert.
L’opinion publique israélienne a clairement montré ses priorités. Le retour des otages était plus important que l’objectif militaire, ce qui est compréhensible.
Je me demande comment la région pourra vraiment avancer après tant de violence. Un vrai défi pour les prochaines années.