Listen to the article
Le 22 septembre, le Leem, syndicat de l’industrie pharmaceutique en France, déclarait que « la spirale du déclassement sanitaire de notre pays [était] enclenchée » et demandait des « Etats généraux du médicament ». Si les groupes pharmaceutiques multinationaux se portent très bien, le tissu de petites et moyennes structures industrielles, en France et en Europe, peine souvent, cantonné à un rôle de sous-traitant des grands groupes et dépendant de leurs volontés. Dans le même temps, pénuries de vieux médicaments et prix de plus en plus extrêmes des nouveaux pèsent sur les malades et les systèmes de santé.
L’état actuel des politiques du médicament est le résultat d’une histoire sociale et politique que l’on peut retracer. La sociologie nous permet de revenir sur les contextes de fabrication du système complexe de règles régissant la production et l’usage de médicaments, ainsi que les modalités de relation entre les acteurs (pouvoirs publics, industriels, professionnels de santé, patients) qui y ont présidé.
Différents travaux ont documenté la façon dont s’est développée une action collective démarrée et nourrie par des acteurs issus des multinationales pharmaceutiques. Emanant des pays riches dans lesquels elle s’est fortement institutionnalisée, et s’appuyant sur d’importantes ressources économiques et un accès aux élites, cette action a conduit depuis les années 1980 à de nombreuses transformations du cadre législatif en matière de « propriété intellectuelle ». Il s’agit d’abord des règles internationales incluses dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce à sa création, en 1994. Puis de leurs déclinaisons nationales : lois amendées à l’aide de textes introduits par des relais de l’industrie, en direct ou à travers la signature d’accords de « libre-échange ». Mais aussi, à partir des années 2010, des règles nouvelles sur le « secret des affaires ».
Or, ces deux types de pouvoirs – être en position de monopole sur les marchés et pouvoir imposer le secret sur la chaîne de valeur des produits de santé – déterminent l’économie politique du secteur et les impasses dans lesquelles nous nous trouvons. D’autant que l’Etat s’est peu à peu dispensé de compétences et reposé sur les conseils venant du monde industriel – juridiquement qualifiés mais aussi animés d’un agenda propre, différent et souvent éloigné de celui de l’intérêt général et de la santé publique.
Il vous reste 38.47% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
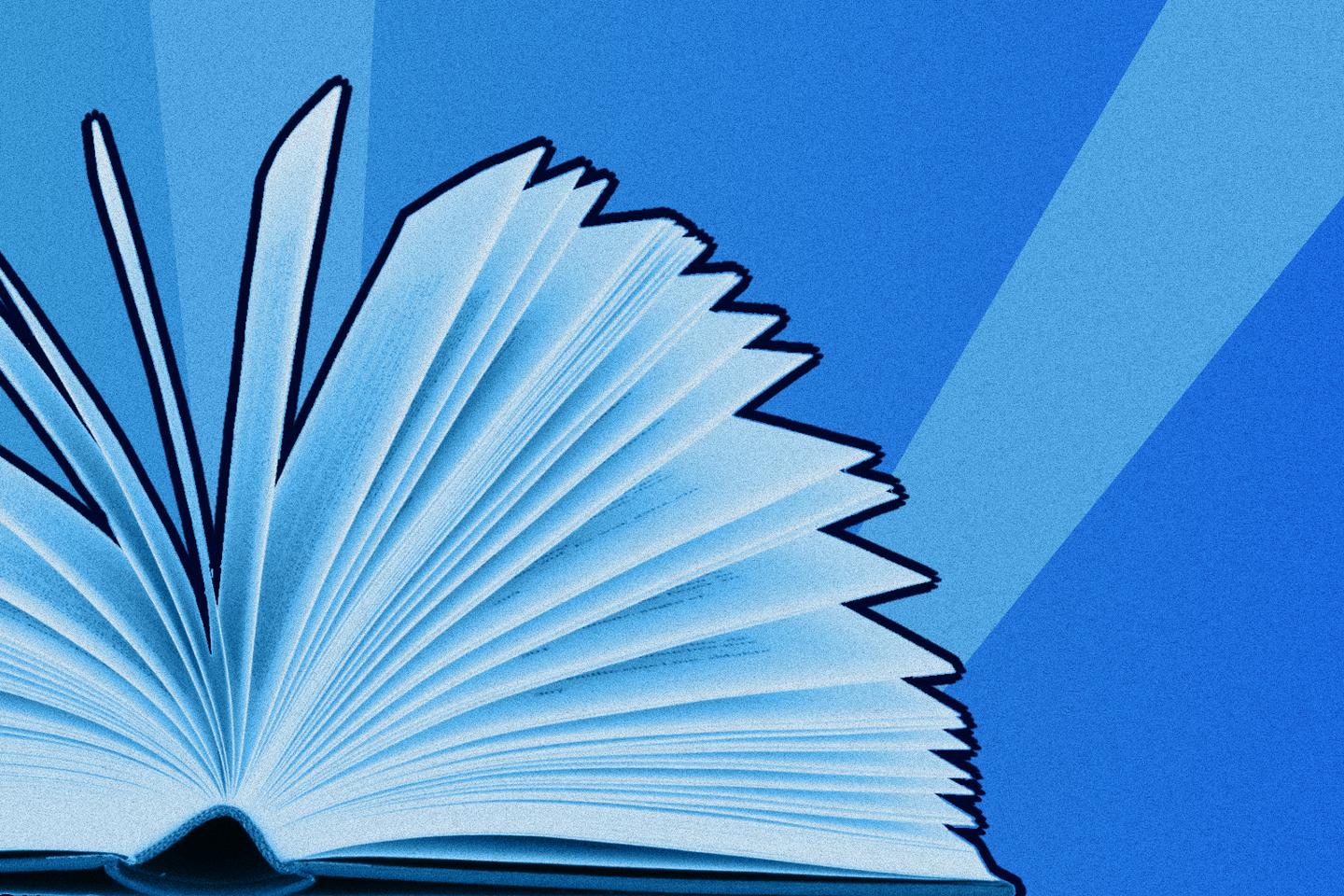


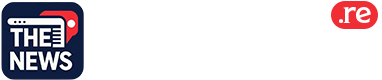
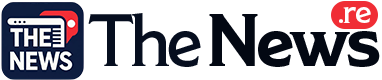
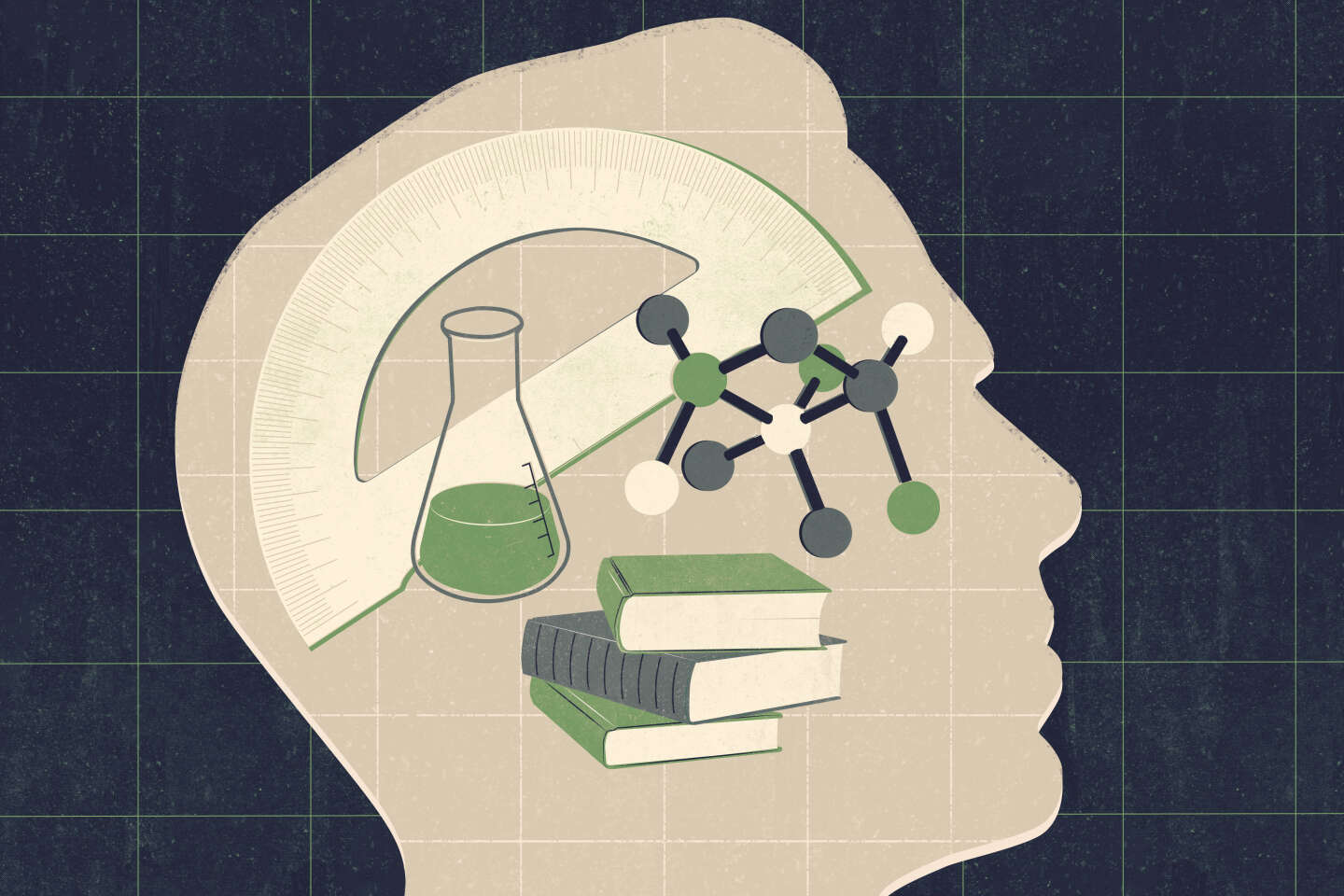

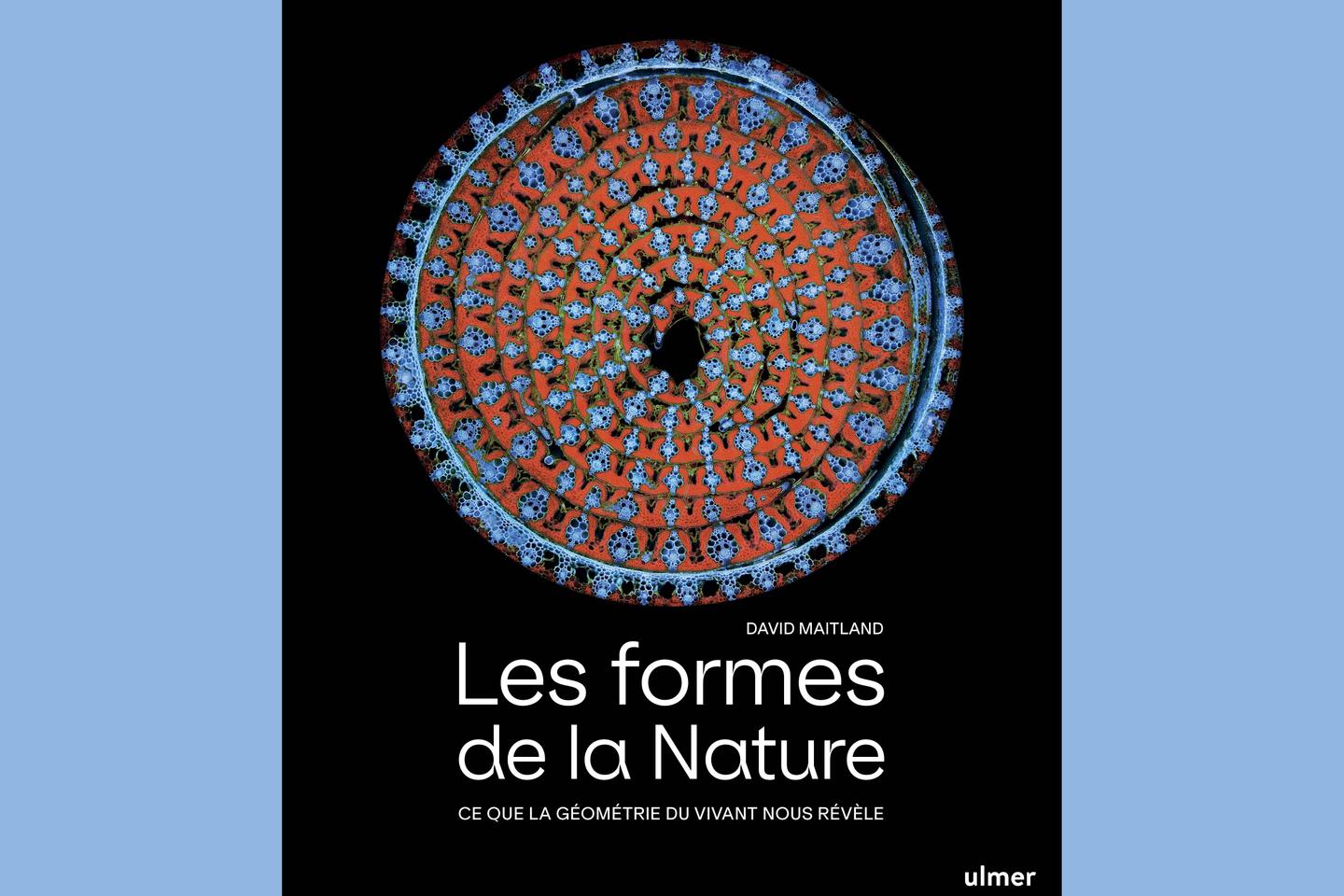


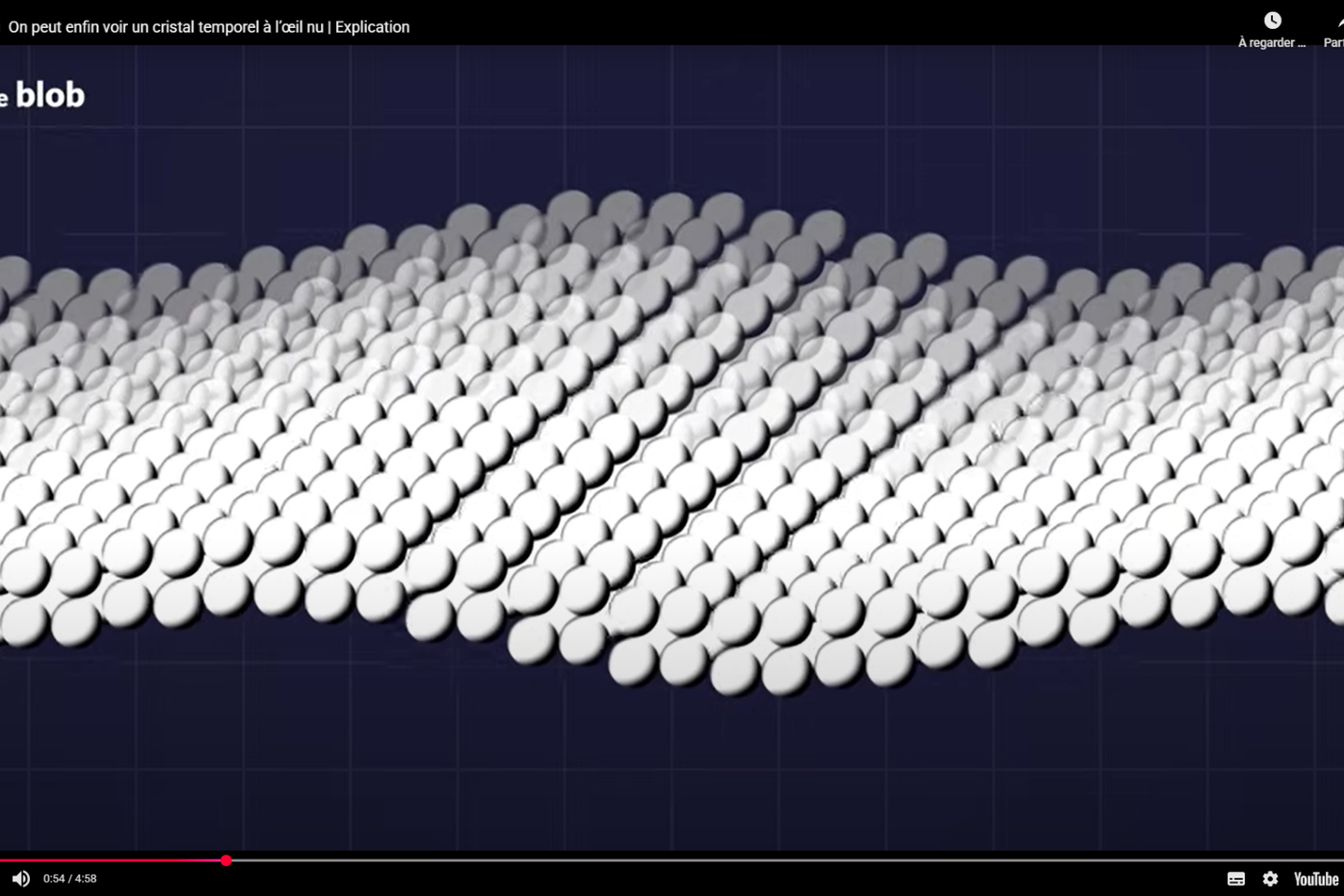

21 commentaires
On oublie souvent que les pénuries concernent aussi les médicaments anciens. Comment renforcer leur production ?
La priorité doit être donnée aux traitements essentiels, même s’ils ne sont plus rentables commerciale…
Peut-on réellement parler d’une spirale de déclassement sanitaire ? Les statistiques sont-elles réellement alarmantes ?
Les données doivent être analysées avec précaution, mais les témoignages sur le terrain confirment certaines difficultés.
Ces pénuries de médicaments rappellent l’importance d’une production locale diversifiée. Pourquoi les petits fabricants ne bénéficient-ils pas d’un meilleur soutien?
Cela dépasse le cadre purement économique, la santé publique devrait primer sur d’autres considérations.
Effectivement, la dépendance aux grands groupes internationaux est un problème récurrent.
Une réflexion collective sur les prix des médicaments est indispensable. Les patients et les professionnels de santé doivent être entendus.
Tout à fait d’accord, les coûts exorbitants des traitements posent un problème d’accès aux soins.
Les petits fabricants sont-ils condamnés à jouer les sous-traitants pour les grands laboratoires ?
Cela dépendra des politiques industrielles futures. La France doit-elle soutenir autrement ?
La France doit-elle vraiment s’inspirer des modèles étrangers pour sa politique du médicament ?
Les comparaison internationales pourraient effectivement éclairer certaines décisions.
La concentration du secteur pharmaceutique semble délétère. Faut-il encadrer davantage les fusions ?
La réglementation actuelle est-elle adaptée à la réalité économique actuelle ?
Les pénuries médicamenteuses donnent l’impression d’un système à bout de souffle. Quelles solutions durables ?
Une meilleure planification nationale et européenne serait sans doute nécessaire.
La sociologie offre une perspective intéressante, mais des actions concrètes sont-elles envisagées ?
Les analyses historiques doivent déboucher sur des réformes concrètes, effectivement.
Quel rôle les patients pourraient-ils jouer dans ces États généraux du médicament ?
Leur expérience ancienne est essentielle pour une politique plus humaine.