Listen to the article
Ah ! les fameuses « réceptions de l’ambassadeur »… Jadis vantées pour leur « goût raffiné », elles ont fini par écœurer. « La blague Ferrero, on me l’a sortie en long, en large et en travers », se désole Luna Le Morvan, faisant allusion au spot publicitaire des années 1990 dans lequel des convives en smoking et au brushing parfait salivaient devant des pyramides de bouchées chocolatées emballées dans du papier doré. La jeune diplômée de Sciences Po Paris en diplomatie européenne a droit régulièrement au cliché, déployant « un peu d’énergie » à le démonter.
Aujourd’hui encore, le métier de diplomate intrigue, suscite de l’admiration, parfois de l’envie, charriant son lot de railleries et de fantasmes. A l’évocation de ce monde feutré, les images s’empilent : le cynisme de Talleyrand, la figure du marquis de Norpois finement décrite par Marcel Proust, la tasse de thé dans des salons dorés, l’art de l’esquive. Ou encore son « langage », brocardé dans la BD Quai d’Orsay, de Christophe Blain et Abel Lanzac (Dargaud, 2010), où un jeune conseiller apprend à composer avec un ministre survolté – inspiré de Dominique de Villepin – tout en absorbant la culture du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), dont chaque nouvelle recrue doit se nourrir pendant au moins trois ans avant d’être affectée à l’étranger.
Il vous reste 88.35% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.



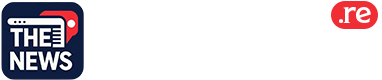
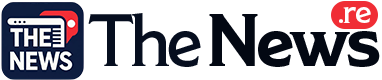






9 commentaires
Les clichés ont la vie dure, comme le prouve cet article. Pourtant, la diplomatie moderne semble bien plus pratique et moins mondaine qu’on ne l’imagine.
La diplomatie inspire autant d’idéalisme que de cynisme. Comment concilier ces deux visons dans la réalité du travail ?
C’est paradoxal, mais peut-être nécessaire pour naviguer dans un monde aussi complexe.
Pourquoi la diplomatie attire-t-elle autant, malgré son image parfois caricaturée ? S’agit-il d’une fascination pour le pouvoir ou pour la transcendance des nationalités ?
Entre le glamour des réceptions et la réalité des négociations, le décalage semble énorme. Dommage que l’article ne creuse pas ce point.
L’image des salons dorés perdure, mais le métier exige bien plus que du savoir-vivre. Quelqu’un d’initiés pourrait éclairer ce paradoxe ?
La diplomatie mérite-t-elle cette aura glacée et aristocratique qu’on lui prête ? Les jeunes candidats semblent l’envisager autrement.
Entre la blague Ferrero et les salons feutrés, on croirait lire un roman de Proust. La diplomatie est-elle encore perçue comme un monde à part ?
Peut-être, mais avec le réchauffement climatique, les enjeux stratégiques redonnent de la valeur à cette fonction.